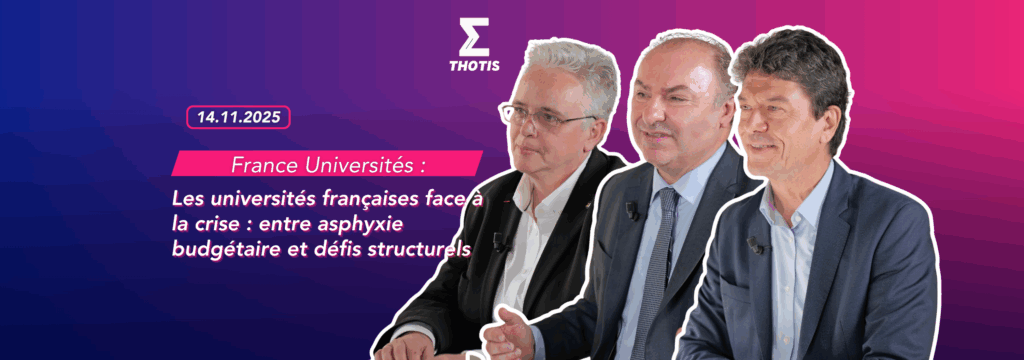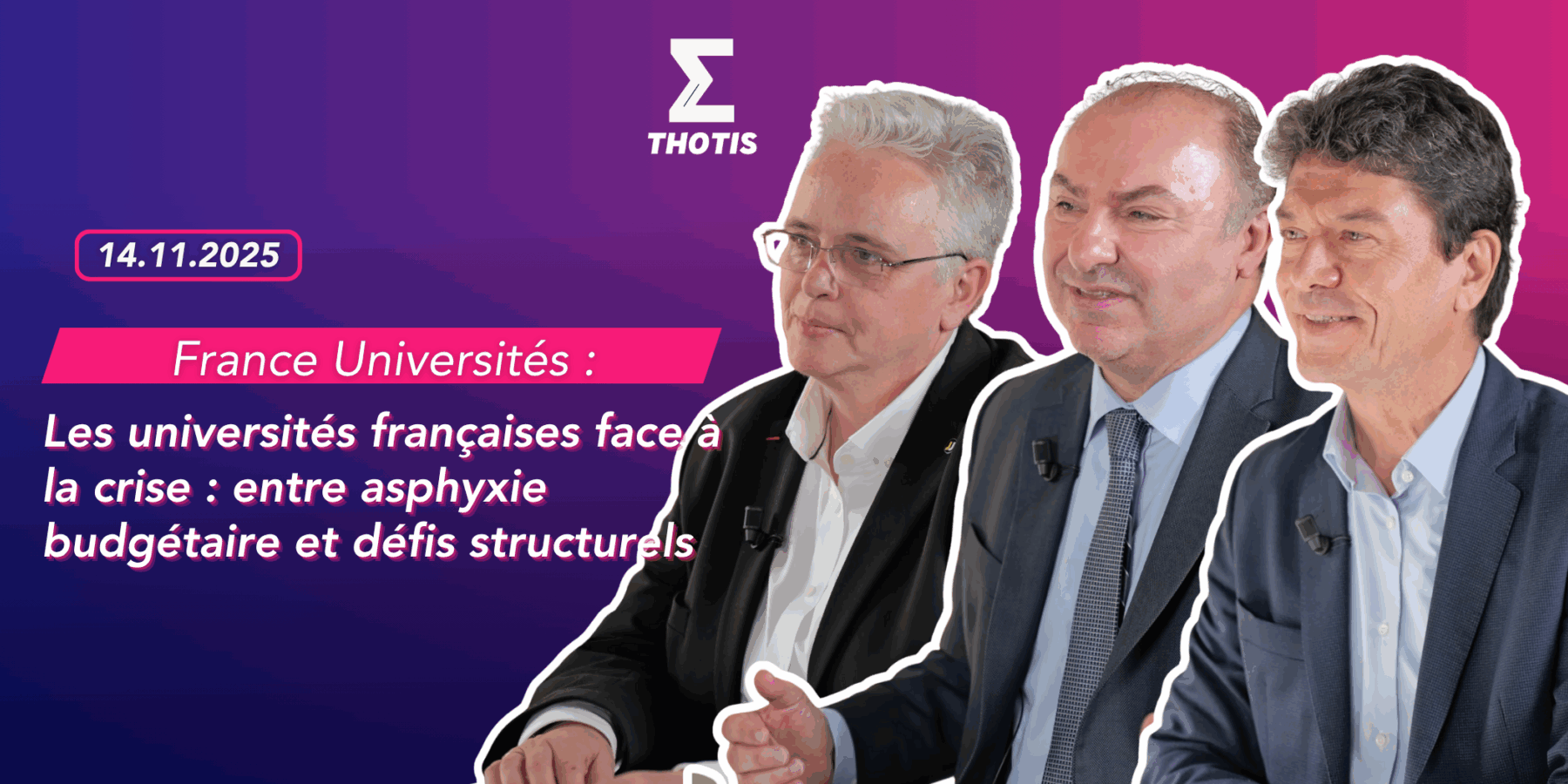Lamri Adoui, président de France Universités depuis bientôt un an, tire la sonnette d’alarme. Avec ses deux vice-présidents Hélène Boulanger et Jean-François Huchet, il dresse un constat sans concession : les universités françaises, qui accueillent près de 2 millions d’étudiants et hébergent 90% de la recherche publique, sont en train de suffoquer financièrement.
Par Thibaud Arnoult
Un système à bout de souffle
« La situation est grave aujourd’hui », affirme sans détour Hélène Boulanger, vice-présidente de France Universités. Derrière cette formule lapidaire se cache une réalité que les établissements d’enseignement supérieur vivent au quotidien depuis plusieurs années : une augmentation constante de leurs missions sans les moyens correspondants.
Le constat est accablant. Les universités forment toujours plus d’étudiants chaque année depuis plus d’une décennie, démultiplient leurs actions auprès des entreprises et des territoires, mais disposent de « toujours moins de titulaires » pour accomplir ces missions. « Nous faisons des efforts depuis des années et nous ne pouvons pas en bénéficier ou en faire bénéficier nos étudiants », déplore Hélène Boulanger.
La vice-présidente pointe du doigt un système de financement qui « manque de cohérence », notamment en raison de transferts de charges non compensés. Le principe du « décideur-payeur » n’est tout simplement pas respecté : « Quelqu’un décide et c’est quelqu’un d’autre à qui on demande de prendre en charge les coûts de cette décision. »
À lire également sur Thotis, en lien avec cet article : les priorités du bureau de France Universités pour 2025-2026 :
Quand le ministre relativise, les universités comptent les dégâts
La réaction du ministre de l’Enseignement supérieur Philippe Baptiste, qui a récemment relativisé la situation en déclarant que « ce n’est pas Zola non plus », a fait grincer des dents. « Les communautés universitaires dans leur ensemble apprécieront la formule et sa portée », répond, cinglante, Hélène Boulanger.
Car derrière les chiffres, il y a une réalité concrète que vivent les établissements : réduction du nombre d’emplois publiés, coupes dans les allocations de fonctionnement, restrictions budgétaires généralisées. « C’est moins de livres dans les bibliothèques universitaires, moins d’abonnements, moins d’efforts pour entretenir le réseau wifi », énumère la vice-présidente. Et d’ajouter, non sans une pointe d’ironie : « Est-ce que c’est tout à fait normal aujourd’hui qu’une université ne soit pas en situation de pouvoir réparer un trou dans une toiture ? »
Les conséquences de cette asphyxie progressive sont déjà visibles. À Sorbonne Université, une école de psychomotricité a dû fermer ses portes. Ce n’est probablement que le début. « À minima, oui, on risque des fermetures de formations, si ce n’est des fermetures de composants, voire de campus à moyen ou long terme », prévient Hélène Boulanger.
La prolifération du privé lucratif : une concurrence déloyale
Pendant que les universités publiques se battent pour maintenir la qualité de leurs formations avec des budgets contraints, l’enseignement supérieur privé lucratif prospère. Près de 800 000 étudiants sont aujourd’hui inscrits dans le privé, une situation qui inquiète profondément France Universités.
« Notre préoccupation est de deux ordres », explique Lamri Adoui. « D’abord, ne pas tromper les familles. Ensuite, garantir la qualité des formations. » Le président pointe du doigt les pratiques trompeuses de certains établissements qui utilisent des appellations réservées comme « master » ou « université » sans en avoir le droit, créant une confusion préjudiciable pour les étudiants et leurs familles.
« Il y a de la duperie quelque part », constate-t-il. « C’est d’autant plus inquiétant que souvent les familles qui sont prêtes à engager des moyens financiers importants pour des formations qui ne sont pas finalement dignes de qualité ne sont pas forcément les familles les plus aisées. »
Le projet de loi déposé par le ministère avant la chute du gouvernement Bayrou tentait de réguler ce secteur en introduisant deux statuts : le « partenariat » réservé aux établissements publics et privés non lucratifs, et l' »agrément », accessible à tous. Une première étape jugée nécessaire mais insuffisante par France Universités. « On aurait tendance à dire que ça ne va peut-être pas tout à fait assez loin », tempère Lamri Adoui.
Parcoursup et Mon Master : des outils perfectibles
Sur le front de l’orientation, le bilan est plus nuancé. Parcoursup, six ans après sa mise en place, « s’améliore » selon le président de France Universités. La plateforme offre désormais davantage d’informations aux candidats, avec 80% de propositions dès l’ouverture. « Nous avons tout intérêt à continuer à fiabiliser, à développer et à renforcer la crédibilité de cette plateforme », insiste-t-il.
L’objectif est clair : faire de Parcoursup « une zone de confiance », « un gage de qualité ». Si les formations présentes sur la plateforme sont reconnues pour leur sérieux, celles qui n’y figurent pas devraient être « un peu stigmatisées, au point de ne plus être reconnues comme un label de qualité. »
Concernant Mon Master, lancé en 2023, Lamri Adoui salue les progrès accomplis. « Il faut se rappeler d’où nous venons. Il n’y avait aucune campagne synchronisée, aucune visibilité nationale sur les places en master. » Désormais, la plateforme évite qu’un étudiant puisse accepter simultanément plusieurs masters, laissant des places vides alors que d’autres candidats sont en demande.
À lire aussi, sur Thotis, en lien avec cet article : Crise budgétaire et politique : l’enseignement supérieur français sous pression :
Crise budgétaire et politique : l’enseignement supérieur français sous pression
PASS-L.AS : une réforme qui doit prendre son temps
La réforme des études de santé cristallise les tensions. Si la Cour des Comptes a pointé le manque de lisibilité de l’offre avec la coexistence de PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé) et L.AS (Licence Accès Santé), France Universités appelle à ne pas précipiter les choses.
« On comprend qu’il faille clarifier un certain nombre de choses », reconnaît Lamri Adoui. Mais il rappelle une contrainte fondamentale : « Le temps universitaire, ce n’est pas toujours le temps politique. » Pour qu’une formation ouvre en septembre 2026, elle doit être inscrite sur Parcoursup en novembre 2025 ; autrement dit, maintenant. « Il faut prendre le temps de cette concertation », plaide-t-il.
D’autant que cette réforme est « systémique » : elle impacte l’ensemble de l’université, pas seulement les filières de santé. « Quand vous adossez, par exemple, des licences accès santé à des mathématiques, à de la psychologie, à des STAPS, vous touchez de façon systémique l’ensemble de l’organisation de l’établissement », explique le président de France Universités. « Nous n’avons pas le luxe de la rater. »
Des questions sur ta poursuite d’études ? Viens discuter avec Thotis.IA, le conseiller d’orientation 2.0 généré par une intelligence artificielle
La précarité étudiante : un plateau haut et stable
Sur la question de la précarité étudiante, le constat est préoccupant. « Elle est stable, mais elle est haute », résume Lamri Adoui. Depuis 5-6 ans, les enquêtes de l’Observatoire de la vie étudiante révèlent une situation critique sur des cohortes importantes et géographiquement diversifiées.
La crise du Covid a mis en lumière l’ampleur du problème : précarité numérique, alimentaire, économique, enjeux de santé mentale… Les besoins primaires des étudiants -se loger, se nourrir, se déplacer, se soigner- ne sont pas toujours satisfaits. Une réalité que confirme Hélène Boulanger avec gravité : « Nous avons des étudiants qui, Zola s’y retrouvera peut-être, sont contraints d’accéder aux ressources des banques alimentaires pour pouvoir se nourrir. »
Face à cette situation, France Universités soutient une réforme en profondeur du système des bourses. Plusieurs pistes sont évoquées : réestimation des barèmes (le nombre d’étudiants boursiers diminue en France), linéarisation des aides pour éviter les effets de seuil, distinction entre étudiants décohabitants et cohabitants, agrégation des aides sociales…
Sur la question épineuse de la modulation des frais de scolarité, à l’image de Sciences Po ou Dauphine, la position est claire : « Pour nous, ce qui importe, c’est l’égalité des chances », affirme Hélène Boulanger. « Mais aujourd’hui, le premier frein pour l’égalité des chances, c’est le système des bourses, des aides sociales pour les étudiants. » Autrement dit : pas question de discuter des frais de scolarité tant que le système de bourses n’aura pas été réformé.
Liberté académique : un combat pour la démocratie
Dans un contexte international inquiétant, de la Hongrie aux États-Unis en passant par plusieurs pays émergents, la question de la liberté académique devient centrale. C’est pourquoi France Universités a commandé un rapport sur le sujet, publié en octobre dernier.
« Nous constatons que ces atteintes aux libertés académiques se sont approfondies dans un certain nombre de pays », observe Jean-François Huchet, vice-président de France Universités. « Certaines proviennent de l’étranger, proviennent de pays qui cherchent à contrôler leur image et qui cherchent à contrôler le narratif produit par les chercheurs français. »
Mais les menaces ne viennent pas uniquement de l’extérieur. « On a aussi des atteintes plus difficiles à qualifier et à repérer à l’intérieur même de la sphère nationale qui peuvent aller d’interventions politiques ou provenant des réseaux sociaux », ajoute-t-il.
D’où l’idée de constitutionnaliser la liberté académique, comme l’ont fait l’Allemagne, l’Italie ou les États-Unis. « Il faut que le grand public en ait conscience, et en particulier les étudiants, que la liberté académique, comme la liberté de la presse, c’est un des piliers de la démocratie », insiste Jean-François Huchet. « Quand c’est attaqué, on attaque aussi la démocratie. »
Cette constitutionnalisation ne serait pas une protection absolue ; l’exemple américain le démontre. « Mais c’est par la multiplication de ces mécanismes de protection que l’on pourrait la ralentir. », souligne-t-il.
Télécharge notre guide Parcoursup et reçois 300 exemples de lettres de motivation
Classements internationaux : un outil à double tranchant
Sur la question des classements internationaux, le discours de France Universités est mesuré. « Oui, on doit les prendre au sérieux », affirme Jean-François Huchet. Ces classements répondent à une demande légitime dans un contexte de circulation internationale croissante des étudiants.
Mais ils ont leurs limites. Certains établissements très spécialisés, comme l’Inalco (dont Jean-François Huchet est le président), ont « un peu de mal à se positionner dans ces grands classements d’universités pluridisciplinaires. » Et surtout, des critères essentiels en sont absents : « La question des libertés académiques n’apparaît pas du tout », regrette-t-il.
Le risque d’un enseignement supérieur à deux vitesses entre grandes universités issues de fusions et établissements plus régionaux existe. Mais pour le vice-président, « il faut transformer cette hétérogénéité en force, chacun utilisant ce qui peut lui permettre de s’exprimer au mieux dans le contexte qui est le sien. » D’autant que « nous avons des formations de très grande qualité en dehors des universités qui apparaissent dans les plus grands classements mondiaux. »
L’avenir en suspens
L’instabilité politique actuelle ajoute une couche d’incertitude supplémentaire. « L’absence de visibilité entrave notre action », constate Hélène Boulanger. Comme les chefs d’entreprise, les présidents d’université se trouvent dans l’impossibilité de planifier sereinement l’avenir.
Plus préoccupant encore : « On passe beaucoup de temps à parler des retraites. Penser à demain est quelque chose qui semble très compliqué », déplore la vice-présidente. L’enseignement supérieur et la jeunesse apparaissent comme les grands absents du débat public national.
Dans ce contexte, certaines mesures gouvernementales semblent contre-productives. La suppression des APL pour les étudiants internationaux non européens, prévue dans le projet de loi de finances 2026, en est un exemple. « À l’heure où nous avons besoin de renforcer l’attractivité de la France en matière d’accueil d’étudiants étrangers, cela nous paraît être une mesure qui ne va pas dans le bon sens », regrette Jean-François Huchet.
Le message de France Universités est clair : les universités ne demandent pas l’aumône, mais simplement les moyens de remplir leurs missions de service public. Missions qui n’engagent rien de moins que « l’avenir de la jeunesse » et « la souveraineté et la compétitivité de la nation », comme le rappelle Lamri Adoui. Dans un pays qui se veut une grande puissance, peut-on vraiment se permettre de laisser ses universités suffoquer ?