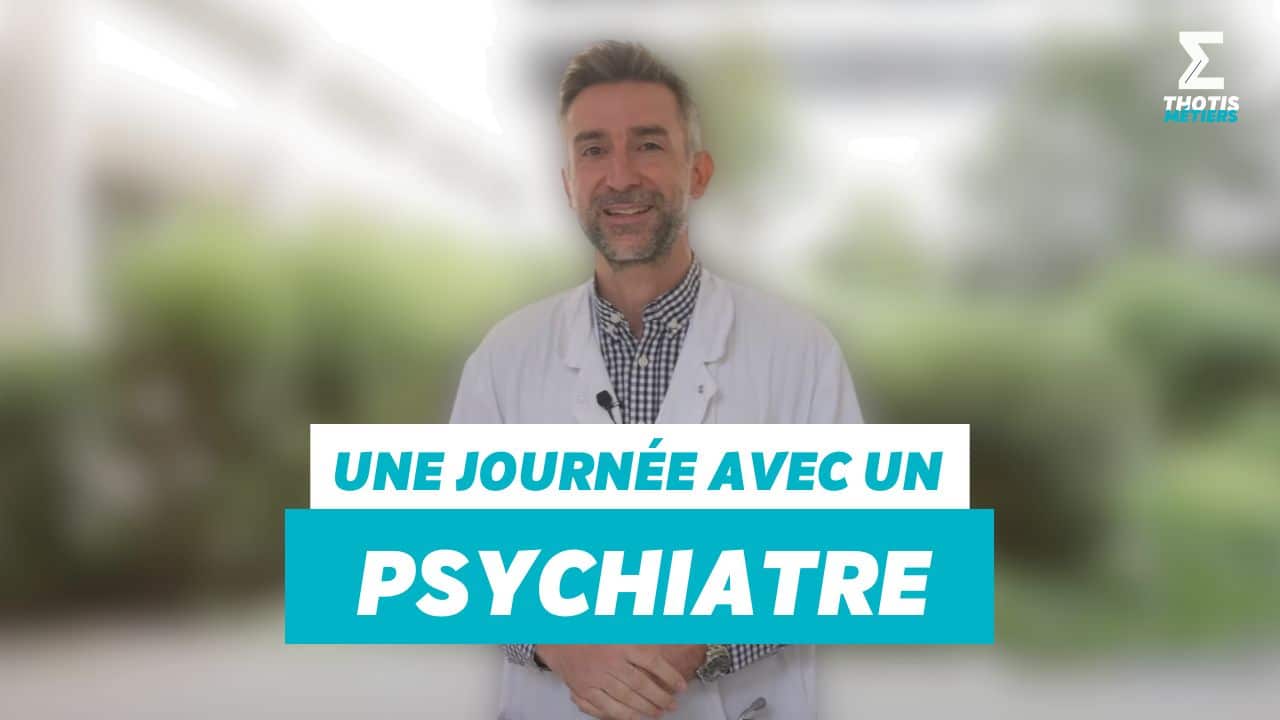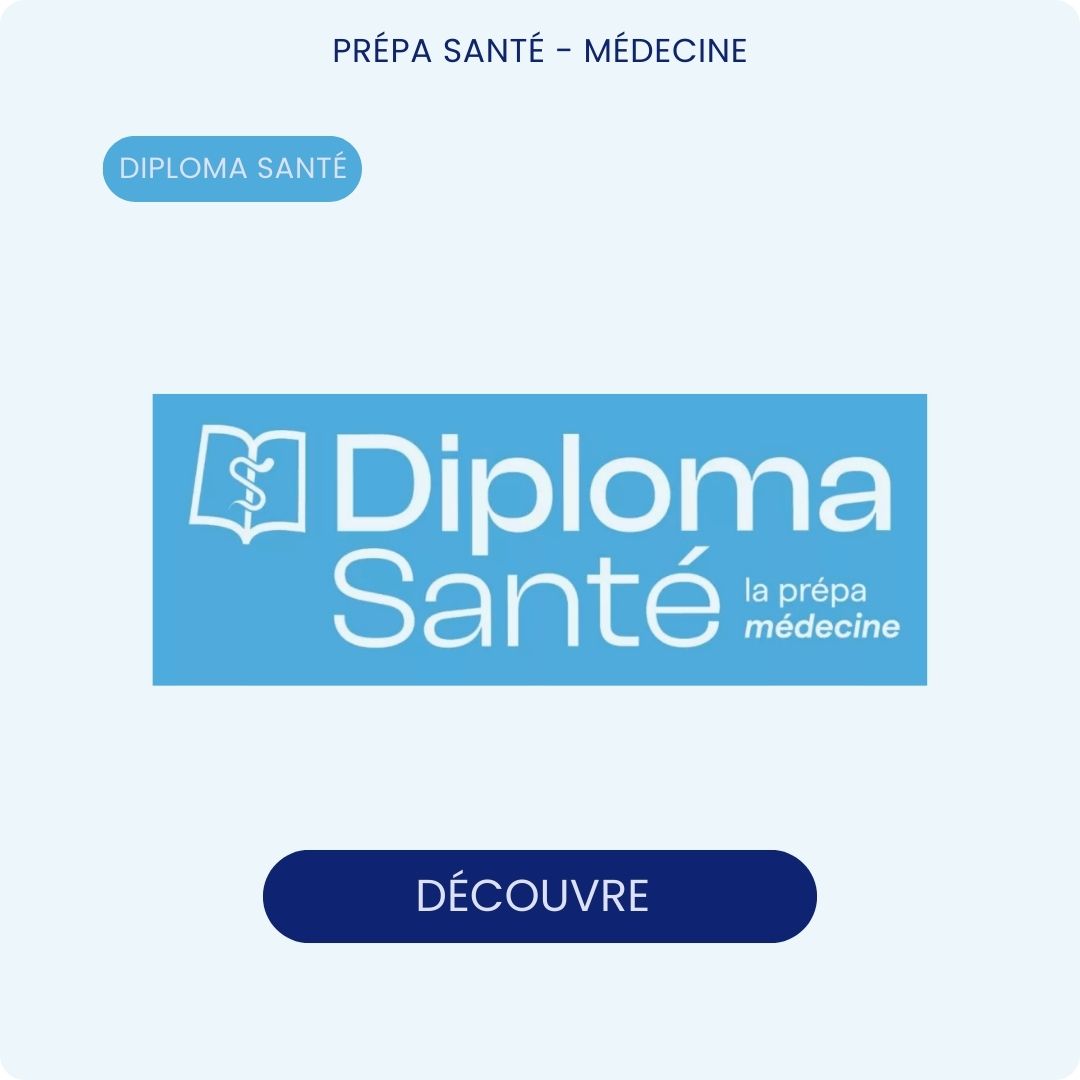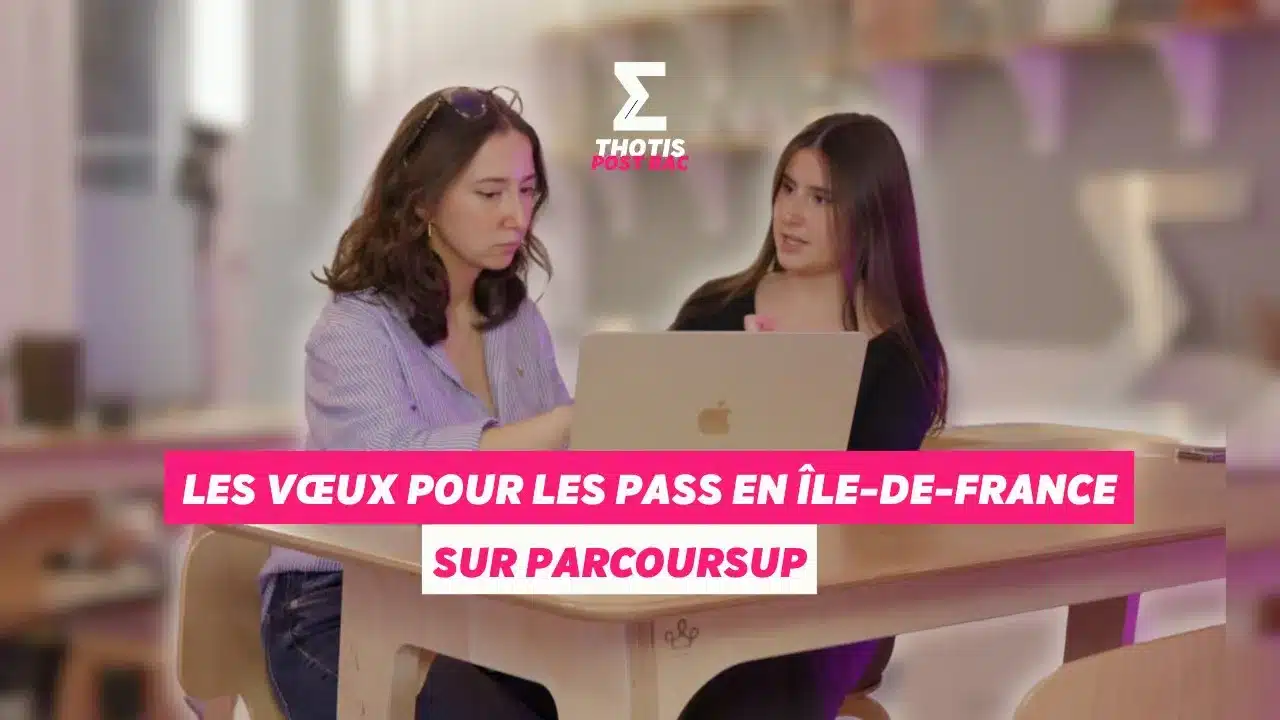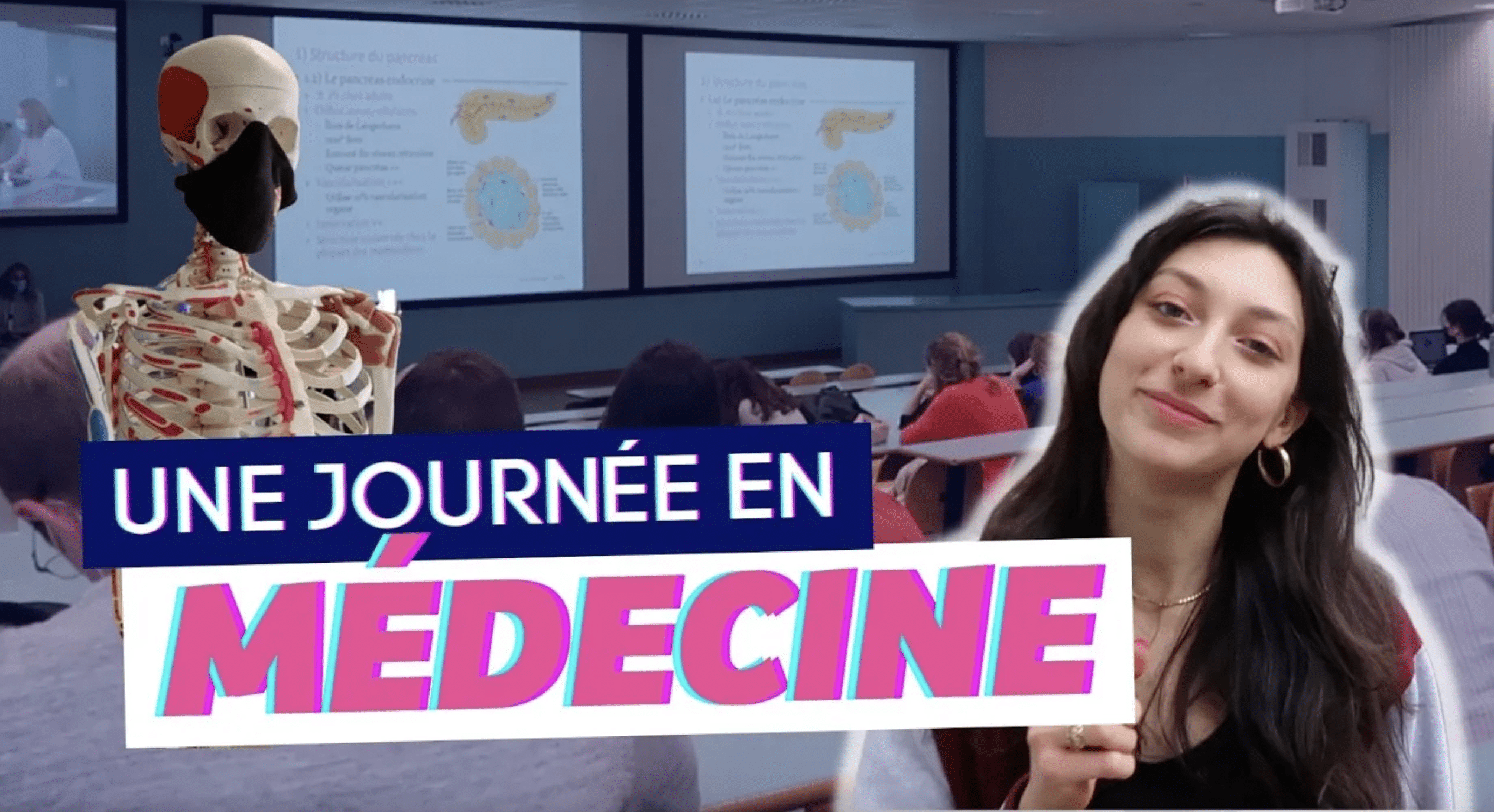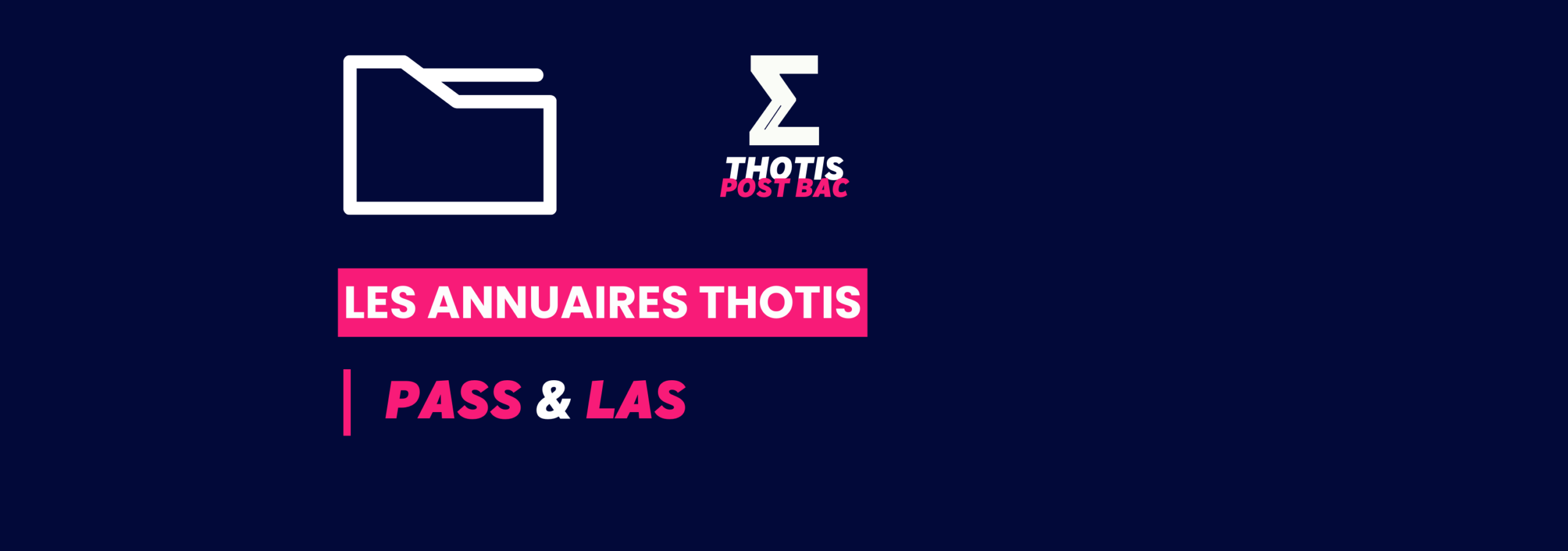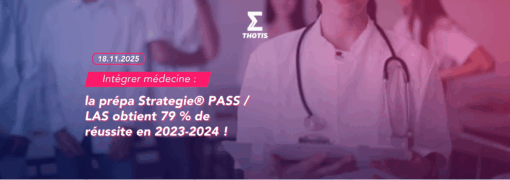Accueil > Post Bac > Orientation > PASS & LAS (ex-PACES) > Les études de Médecine (Externat, EDN, Internat…)
Les études de Médecine (Externat, EDN, Internat…)
Les études de Médecine font partie des filières de santé MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie et Kinésithérapie). L’accès se fait après le baccalauréat, principalement via le PASS (Parcours Accès Spécifique Santé) ou une L.AS (Licence avec Accès Santé), selon les capacités d’accueil et conventions des UFR.
Le cursus se déroule en trois cycles :
- 1er cycle (DFGSM, 2ᵉ–3ᵉ années) : bases scientifiques et cliniques (anatomie, physiologie, sémiologie, santé publique) avec premiers stages d’initiation.
- 2ᵉ cycle (4ᵉ–6ᵉ années, externat) : formation clinique à l’hôpital et en ambulatoire, alternant cours et stages. En début de 6ᵉ année : EDN (classement national) puis ECOS (épreuves cliniques) et prise en compte du parcours pour le choix de la spécialité et de la subdivision.
- 3ᵉ cycle (internat, 4 à 6 ans) : exercice à temps plein en tant qu’interne avec stages semestriels, formation spécialisée (médecine générale ou spécialités médicales/chirurgicales), soutenance de la thèse d’exercice pour obtenir le titre de docteur en médecine.
Tout au long du cursus, l’évaluation combine contrôle continu, examens écrits, oraux, situations cliniques simulées (ECOS) et validation de stages. La validation annuelle conditionne le passage au cycle suivant.
Pourquoi choisir le PASS ou la L.AS pour intégrer les études de médecine ? Quelles conditions d’admission, quel rythme en externat et quelles perspectives après l’internat ?
La sélection pour l’entrée en médecine repose sur un classement sélectif établi après le PASS ou une L.AS, en fonction des capacités d’accueil fixées par chaque université. Certaines facultés organisent aussi des épreuves complémentaires (entretiens, tests écrits). Après un PASS validé sans admission, l’étudiant peut candidater à nouveau en L.AS 2 ou 3, selon les conventions locales.
En PASS, l’étudiant suit une majeure santé (sciences médicales, biologie, anatomie, physiologie) associée à une mineure hors santé. En L.AS, il s’inscrit en licence disciplinaire (sciences, droit, psychologie, STAPS, etc.) avec une mineure santé. Selon les universités, les candidats disposent d’une à deux tentatives au cours de leur licence pour accéder aux études médicales.
Des débouchés variés après les études de Médecine :
- Médecin en cabinet libéral : seul ou en association, le praticien assure le suivi global des patients (consultations, prévention, prescriptions). Cette voie demande autonomie, gestion de son activité et proximité avec la patientèle. Elle peut évoluer vers une spécialisation progressive ou une ouverture de cabinet multi-professionnel associant d’autres praticiens de santé.
- Médecin dans le secteur privé : activité exercée au sein de cliniques privées ou d’établissements spécialisés. Ce parcours attire ceux qui souhaitent bénéficier d’un cadre plus flexible, parfois orienté vers certaines spécialités médicales. Les médecins y trouvent souvent des conditions matérielles optimisées, avec un plateau technique moderne et des opportunités de carrière liées à des partenariats ou des réseaux de soins privés.
- Médecin dans le secteur public : exercice au sein d’hôpitaux publics, centres hospitaliers universitaires (CHU) ou établissements de santé publique. Le médecin travaille en équipe pluridisciplinaire et participe souvent à la recherche clinique et à l’enseignement. Ce cadre valorise la formation continue, la diversité des cas rencontrés et la possibilité de contribuer à la santé publique au sens large, notamment dans des missions de prévention ou d’expertise.
- Médecin en vacation : activité partagée entre plusieurs structures (cliniques, hôpitaux, centres spécialisés) avec des interventions ponctuelles. Ce mode d’exercice offre une diversité de contextes cliniques et une grande flexibilité d’organisation. Il convient particulièrement aux praticiens qui souhaitent diversifier leurs expériences, équilibrer vie professionnelle et personnelle, ou maintenir un lien avec plusieurs spécialités.
Au programme en études de Médecine :
Après une admission via PASS ou L.AS, le cursus de médecine s’organise en plusieurs cycles, alternant enseignements théoriques, stages pratiques et préparation aux épreuves nationales. L’objectif est de former des praticiens capables de diagnostiquer, traiter et accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins, tout en développant des compétences scientifiques solides et une éthique professionnelle forte.
Avec en moyenne 35 à 40 heures de formation hebdomadaire, les étudiants alternent entre :
- Cours magistraux & travaux dirigés : anatomie, physiologie, biochimie, sémiologie, pharmacologie, sciences humaines et santé publique.
- Travaux pratiques : apprentissage des gestes cliniques, dissections anatomiques, simulation médicale et initiation aux examens complémentaires (imagerie, biologie médicale).
- Stages hospitaliers : dès le 2ᵉ cycle, immersion dans les services hospitaliers (médecine générale, chirurgie, pédiatrie, urgences) pour confronter les savoirs théoriques à la pratique clinique.
- Préparation aux examens : contrôles continus, partiels, ECOS (examens cliniques objectifs et structurés) et préparation à l’EDN (Épreuves Nationales) qui conditionnent l’accès à l’internat.
💡 Cette organisation permet une progression structurée : acquisition des bases scientifiques, consolidation par la pratique clinique et montée en compétence jusqu’à l’internat, où l’étudiant choisit sa spécialité médicale et devient progressivement autonome dans la prise en charge des patients.
La médecine en vidéo : immersion avec un professionnel de santé
Comprendre les parcours : Médecine, PASS, L.AS et autres voies scientifiques
Hésites-tu entre le PASS et la L.AS pour intégrer les études de médecine ? Veux-tu comprendre ce qui distingue la médecine des autres filières de santé MMOPK comme la Maïeutique, l’Odontologie ou la Pharmacie ?
Ou encore comparer ce cursus long et exigeant avec d’autres voies proches comme les études en soins infirmiers (IFSI), une licence scientifique, les STAPS ou encore la Psychologie ?
👉 Voici un aperçu clair et structuré pour comparer ces parcours, comprendre leurs objectifs, contenus, modalités d’admission et évaluer les opportunités offertes par la médecine.
PASS ou L.AS : quelle voie choisir pour entrer en médecine ?
Pour accéder aux études de médecine, deux grandes voies coexistent sur Parcoursup : le PASS (Parcours Accès Spécifique Santé) et la L.AS (Licence avec option Accès Santé). Le PASS est la voie la plus directe : une majeure santé combinée à une mineure disciplinaire hors santé, avec une sélection exigeante dès la première année. C’est l’option privilégiée par ceux qui visent avant tout la médecine.
La L.AS, quant à elle, correspond à une licence disciplinaire (sciences, droit, psychologie, STAPS, etc.) intégrant une mineure santé. Elle permet de candidater à plusieurs reprises aux études médicales, tout en offrant une alternative solide en cas de non-admission. 👉 En résumé : le PASS est sélectif et rapide, alors que la L.AS donne davantage de souplesse et sécurise la réorientation.
Médecine vs Maïeutique (sage-femme) : quelles différences dans la durée des études, le contenu et les responsabilités professionnelles ?
Les études de médecine durent entre 9 et 12 ans selon la spécialité choisie. Elles débutent par le PASS ou la L.AS, se poursuivent par le DFGSM (Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales), puis l’externat et l’internat. Les médecins assurent le suivi global des patients : diagnostic, prescription, traitements médicaux ou chirurgicaux.
Les études de maïeutique, elles, durent 5 ans après l’admission en PASS/L.AS. La formation est axée sur la santé de la femme, la grossesse et l’accouchement. Le sage-femme accompagne la maternité, réalise le suivi gynécologique de prévention et participe à l’éducation à la santé. 👉 En résumé : la médecine offre une formation généraliste et longue, tandis que la maïeutique prépare rapidement à une profession spécialisée dans la périnatalité.
Médecine vs Odontologie (chirurgie dentaire) : quelles compétences sont développées et quelles sont les perspectives de carrière dans chaque filière ?
Les études de médecine visent une approche globale de la santé humaine : diagnostic, prévention et traitement des maladies. Elles impliquent un long cursus (9 à 12 ans) et permettent de se spécialiser (médecine générale, chirurgie, pédiatrie, cardiologie, etc.).
Les études d’odontologie, elles, durent environ 6 à 9 ans selon la spécialisation (orthodontie, chirurgie orale, prothèses). Elles se concentrent sur la santé bucco-dentaire et maxillo-faciale. 👉 En résumé : la médecine conduit à une expertise large et transversale, tandis que l’odontologie forme des spécialistes du diagnostic et du soin dentaire.
Suis-je fait·e pour étudier en études de médecine ?
Es-tu fait·e pour des études de médecine ? Fais notre Test d’Orientation Parcoursup, c’est gratuit évidemment !
Médecine vs Pharmacie : quelle approche du soin et quelles opportunités professionnelles après le diplôme ?
Les médecins sont formés pour diagnostiquer, soigner et suivre les patients sur le plan médical. Leur rôle s’inscrit dans la relation directe avec le patient et dans la prise en charge globale, avec une formation longue (jusqu’à 12 ans).
Les pharmaciens suivent 6 à 9 ans d’études après PASS/L.AS. Ils se spécialisent dans la dispensation des traitements, la recherche pharmaceutique, l’industrie ou la biologie médicale. 👉 La médecine forme des cliniciens au contact des patients, tandis que la pharmacie ouvre des carrières variées allant de l’officine à la recherche biomédicale.
Médecine vs Kinésithérapie : quelle place pour la relation patient et les techniques de soins dans ces deux parcours de santé ?
Les études de médecine forment des praticiens capables de diagnostiquer et traiter toutes sortes de pathologies, avec une spécialisation ultérieure selon la discipline choisie. L’accent est mis sur le raisonnement clinique, la prescription et la prise en charge globale.
Les études de kinésithérapie, d’une durée de 5 ans, sont centrées sur la rééducation fonctionnelle, la prévention et l’accompagnement du patient par le mouvement et les techniques manuelles. 👉 En résumé : le médecin établit le diagnostic et le plan de traitement, tandis que le kinésithérapeute assure la rééducation et le suivi fonctionnel.
Médecine vs Licences scientifiques (biologie, sciences de la vie, STAPS) : quelles passerelles et quelles alternatives en cas de réorientation après PASS ou L.AS ?
Les études de médecine forment des praticiens de santé sur le long terme (9 à 12 ans). L’exigence est forte, mais les débouchés sont nombreux, que ce soit en médecine générale, hospitalière ou spécialisée.
Les licences scientifiques (biologie, sciences de la vie, STAPS) offrent une formation universitaire plus courte (3 à 5 ans). Elles permettent une réorientation vers l’enseignement, la recherche ou des masters spécialisés. 👉 Ces licences constituent souvent un plan B solide pour les étudiants ayant tenté PASS/L.AS, avec la possibilité de retenter une candidature vers une filière santé ou de s’orienter vers d’autres domaines scientifiques.
Les conseils de Thotis pour réussir en PASS/LAS (ex-PACES)
Questions fréquentes sur les études de Médecine :
Tu veux tout comprendre sur les études de médecine ? On t’explique l’essentiel : durée et organisation des cycles (premier, deuxième et troisième cycles), modalités d’accès après le PASS/L.AS, contenus de formation (cours fondamentaux, stages, externat, internat), épreuves clés comme les EDN et ECOS, choix de spécialité et répartition des postes d’internat, ainsi que les conditions d’exercice selon les secteurs (libéral, privé, public, vacations).
👉 Objectif : t’aider à visualiser concrètement ton parcours en médecine, anticiper les étapes stratégiques (choix entre PASS et L.AS, préparation aux concours et stages, orientation vers une spécialité), et préparer ton avenir professionnel de futur médecin.
Comment savoir si PASS/LAS est fait pour moi ?
Es-tu fait·e pour étudier en PASS/LAS ? Fais notre Test d’Orientation, c’est gratuit évidemment !
Combien de temps durent les études de médecine et comment sont organisés les cycles ?
Les études de médecine s’étendent sur 9 à 12 ans après le baccalauréat, selon la spécialité choisie. Elles sont structurées en trois cycles :
- 1er cycle (DFGSM – Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales, 3 ans) : enseignements fondamentaux (sciences biomédicales, anatomie, physiologie, sémiologie) et premiers stages.
- 2e cycle (DFASM – Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales, 3 ans) : externat avec stages hospitaliers, approfondissement clinique et préparation aux épreuves nationales (EDN, ECOS).
- 3e cycle (DES – Diplôme d’Études Spécialisées, 3 à 6 ans selon la spécialité) : internat, stages en hôpital ou cabinet, thèse d’exercice et obtention du titre de docteur en médecine.
Comment accéder aux études de médecine après le bac (PASS/L.AS) et qui fixe les places ?
L’accès aux études de médecine se fait principalement via PASS (Parcours Accès Spécifique Santé) ou L.AS (Licence avec Accès Santé), sur Parcoursup. Le nombre de places disponibles (appelé numerus apertus) est fixé chaque année par les universités et les agences régionales de santé (ARS), en fonction des besoins de santé du territoire. Les candidats sont sélectionnés sur leur dossier académique, leurs résultats universitaires et parfois des épreuves complémentaires.
Que sont les EDN et les ECOS dans les études de médecine et à quoi servent-ils ?
Les Épreuves Déterminantes Nationales (EDN) et les Épreuves Cliniques Objectifs Structurées (ECOS) remplacent l’ancien concours de l’internat. Elles sont organisées en fin de 2e cycle :
- EDN : épreuves écrites évaluant les connaissances médicales fondamentales.
- ECOS : mises en situation pratiques avec patients standardisés pour tester les compétences cliniques et relationnelles.
Leur combinaison établit un classement national qui détermine le choix de la spécialité et de la ville d’internat.
Qu’est-ce que l’externat en études de médecine (stages, statut, évaluations) ?
L’externat correspond aux 4e à 6e années de médecine. L’étudiant est alors considéré comme un étudiant hospitalier :
- Stages hospitaliers : rotation dans différents services (médecine générale, chirurgie, pédiatrie, urgences…).
- Enseignements théoriques : cours magistraux, conférences de cas cliniques et préparation aux EDN/ECOS.
- Statut : rémunération modeste et responsabilités progressives au sein de l’équipe médicale.
- Évaluations : validation des stages, examens écrits et oraux, compétences cliniques.
Comment choisit-on sa spécialité et sa ville d’internat en études de médecine ?
Le choix de spécialité (médecine générale, pédiatrie, chirurgie, psychiatrie, etc.) et de ville d’internat se fait à la fin du 2e cycle, sur la base du classement national obtenu aux EDN et aux ECOS. Chaque étudiant choisit, selon son rang, parmi les postes ouverts au niveau national. Plus le classement est élevé, plus le choix est large. Ce système garantit une répartition équitable des étudiants dans les différentes spécialités et régions.
Quel est le programme des 1er et 2e cycles des études de médecine ?
Les deux premiers cycles associent sciences fondamentales et formation clinique progressive :
- 1er cycle : biologie, anatomie, physiologie, biochimie, santé publique, sémiologie médicale et premiers stages d’observation.
- 2e cycle : approfondissement des pathologies, pharmacologie, médecine d’urgence, stages hospitaliers réguliers et mise en pratique clinique.
L’objectif est d’acquérir de solides bases scientifiques, une maîtrise des gestes cliniques et la capacité d’analyse diagnostique.
Quelles possibilités de réorientation après un échec en études de médecine (PASS/L.AS) ?
En cas d’échec en PASS, l’étudiant peut intégrer une L.AS 2 ou 3 (Licence avec option Accès Santé) et recandidater à médecine, dans la limite de 2 tentatives. Les conventions varient selon les universités, mais l’objectif est de favoriser les passerelles et d’éviter les “années perdues”. Les étudiants peuvent également poursuivre dans leur licence disciplinaire (sciences, droit, psychologie, STAPS, etc.).
Peut-on partir à l’international pendant les études de médecine (Erasmus, stages) ?
Oui, les étudiants en médecine peuvent bénéficier de mobilités internationales, notamment à partir du 2e cycle :
- Erasmus+ : semestres d’études dans des facultés partenaires en Europe.
- Stages à l’étranger : hôpitaux ou laboratoires de recherche dans le cadre d’accords bilatéraux.
Ces expériences permettent de découvrir d’autres systèmes de santé, de renforcer les compétences cliniques et de développer une ouverture internationale.
Combien coûtent les études de médecine et quelles aides financières existent ?
Les droits d’inscription en médecine dans les universités publiques sont relativement faibles : environ 200 à 500 € par an. À cela s’ajoutent les frais liés aux stages, au matériel médical (blouse, stéthoscope) et aux déplacements. Les étudiants peuvent bénéficier de bourses sur critères sociaux, d’aides régionales ou de dispositifs comme les contrats d’engagement de service public (CESP), qui financent une partie du cursus en échange d’un engagement professionnel futur.
Quand obtient-on le titre de docteur en médecine et quel lien avec le DES ?
Le titre de docteur en médecine s’obtient à la fin du 3e cycle, après la soutenance d’une thèse d’exercice. Le DES (Diplôme d’Études Spécialisées) valide la formation clinique dans la spécialité choisie (médecine générale, cardiologie, chirurgie, etc.). En pratique :
- DES validé = reconnaissance de la spécialité.
- Thèse d’exercice soutenue = obtention du titre de docteur en médecine et droit d’exercice en France.
Les deux démarches sont complémentaires et obligatoires pour exercer légalement comme médecin.
Les études de Médecine en vidéo : immersion avec des étudiants
Où peut-on trouver un PASS ou une LAS (ex-PACES) pour accéder à des études de Médecine ?
Découvre l’annuaire des PASS et des L.AS ainsi que leur classement.
Tu veux en savoir plus sur les études de médecine et comprendre comment se déroule ce long parcours de formation ? On t’explique l’essentiel : organisation du cursus et ses étapes clés après le PASS/L.AS, enseignements fondamentaux (anatomie, physiologie, sémiologie, pharmacologie, santé publique), progression des stages cliniques dès l’externat en hôpitaux et centres spécialisés, et modalités de spécialisation lors de l’internat.
👉 Objectif : t’aider à visualiser concrètement ton parcours, anticiper les choix stratégiques (PASS vs L.AS, externat, préparation des EDN et choix de spécialité) et préparer ton avenir dans la filière médecine.
Le médecin en cabinet libéral
📚 Un mode d’exercice autonome et au cœur du système de soins
Le métier de médecin en cabinet libéral représente aujourd’hui l’une des voies les plus répandues et symboliques de la médecine générale et spécialisée en France. Ce choix d’exercice séduit de nombreux jeunes diplômés à l’issue de leur DES (Diplôme d’Études Spécialisées), car il combine à la fois une grande liberté professionnelle et un lien direct avec la population. Le médecin libéral assure la prise en charge globale des patients : prévention, dépistage, suivi des pathologies chroniques, accompagnement psychologique, gestion des urgences du quotidien et coordination des soins avec d’autres professionnels de santé.
👉 L’autonomie dont bénéficie le praticien implique également une dimension entrepreneuriale : choix du lieu d’installation, aménagement du cabinet, embauche éventuelle d’assistants ou de secrétaires, investissement dans du matériel, et gestion comptable et administrative. C’est un mode d’exercice exigeant mais gratifiant, qui repose sur la proximité, la continuité et la personnalisation des soins.
👩🔬 Les étapes de la formation en lien avec la pratique libérale
- 2ᵉ cycle – Externat (4ᵉ à 6ᵉ année) : l’étudiant médecin découvre le quotidien de la pratique médicale à travers ses stages hospitaliers et ambulatoires. Les enseignements théoriques et les ECOS (Examens Cliniques Objectifs Structurés) développent les compétences sémiologiques et relationnelles, indispensables pour la future activité de consultation. 👉 Cette phase permet de comprendre la variété des spécialités et de confirmer une orientation vers la médecine de ville.
- 3ᵉ cycle – Internat en médecine générale (3 ans) : l’interne alterne entre stages hospitaliers et stages en ambulatoire, notamment le SASPAS (Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoires Supervisés). C’est le moment clé où l’étudiant apprend la gestion d’une patientèle, l’organisation des consultations, la prévention, le suivi au long cours, ainsi que l’utilisation d’outils numériques comme le Dossier Médical Partagé (DMP) ou la téléconsultation.
- Thèse et installation : après la soutenance de la thèse d’exercice, le médecin obtient le titre de Docteur en médecine et peut s’installer en cabinet. Il choisit alors son régime conventionnel (secteur 1, secteur 2, OPTAM), élabore son projet médical et définit son mode d’exercice : remplacement, collaboration, association, maison de santé pluridisciplinaire ou installation en solo. 👉 Ce passage demande une préparation rigoureuse, souvent accompagnée par des dispositifs de soutien à l’installation (contrats incitatifs, aides régionales, exonérations fiscales en zone sous-dotée).
🎓 Compétences clés et réalités du métier
À l’issue du cursus, le médecin en cabinet libéral est capable de :
- Prendre en charge la diversité des motifs de consultation : de la fièvre chez l’enfant aux pathologies chroniques de l’adulte (hypertension, diabète, asthme), en passant par la prévention et le suivi gériatrique.
- Assurer une continuité des soins, élément essentiel qui distingue la médecine libérale et favorise une relation de confiance sur le long terme avec les patients.
- Coordonner le parcours de santé : échanges avec infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, spécialistes, et suivi post-hospitalisation. 👉 Le médecin libéral est souvent le pivot du système de santé.
- Gérer l’aspect organisationnel et entrepreneurial : planification des rendez-vous, facturation et télétransmission via la carte Vitale, respect des obligations légales (RGPD, traçabilité des prescriptions), optimisation du temps médical.
- S’investir dans des actions de santé publique : campagnes de dépistage (cancers, VIH, diabète), vaccination, éducation thérapeutique, prévention nutritionnelle ou lutte contre la sédentarité.
🔎 Perspectives et évolutions possibles
Le médecin libéral peut :
- Développer une spécialisation complémentaire via des DU ou DIU (gynécologie de ville, pédiatrie ambulatoire, addictologie, gériatrie, médecine du sport, etc.).
- Intégrer une maison ou un centre de santé pluridisciplinaire, ce qui favorise le travail en équipe, la répartition des charges et la mutualisation des compétences.
- Contribuer à l’enseignement et à la recherche en devenant maître de stage universitaire, en publiant des travaux sur les soins primaires ou en participant à des programmes de recherche clinique en médecine générale.
- Profiter des opportunités liées au numérique en santé : téléconsultations, télésuivi, intelligence artificielle appliquée au diagnostic ou à la prévention.
👉 Exercer en cabinet libéral, c’est conjuguer expertise clinique, proximité humaine et gestion entrepreneuriale. C’est aussi une voie en constante évolution, adaptée aux transformations du système de santé, qui offre une réelle liberté et une grande diversité dans les parcours professionnels.
Le médecin dans le secteur privé
📚 Un exercice attractif et diversifié
Le métier de médecin dans le secteur privé se développe au sein de cliniques, centres spécialisés ou établissements privés de soins. Ce choix attire de nombreux praticiens, car il combine la stabilité salariale avec une grande variété de cas cliniques. Selon la spécialité, le médecin peut être salarié de la clinique, travailler en contrat d’exercice libéral dans une structure privée ou encore exercer en tant que vacataire régulier. 👉 Ce mode d’exercice séduit ceux qui souhaitent pratiquer la médecine dans un cadre souvent plus flexible, doté d’équipements modernes, et en lien étroit avec d’autres praticiens.
👩🔬 Les étapes de la formation en lien avec le secteur privé
- Externat (4ᵉ à 6ᵉ année) : les étudiants découvrent la diversité des disciplines lors de leurs stages hospitaliers. Certains stages peuvent être effectués dans des cliniques privées conventionnées, offrant un premier aperçu de ce mode d’exercice.
- Internat (3ᵉ cycle) : selon la spécialité choisie (chirurgie, anesthésie, médecine interne, cancérologie, etc.), l’interne peut réaliser des stages dans des établissements privés partenaires. 👉 Cela permet d’acquérir des compétences techniques et de comprendre l’organisation interne de ces structures.
- Installation dans le privé : une fois la thèse validée, le médecin peut intégrer une clinique en tant que salarié, s’associer avec d’autres praticiens ou opter pour une activité mixte libérale et privée. Le choix dépend souvent du projet professionnel, du niveau de spécialisation et du secteur géographique.
🎓 Compétences et réalités du métier
Le médecin exerçant dans le privé développe des compétences spécifiques :
- Assurer des consultations spécialisées ou générales selon son champ d’expertise.
- Prendre en charge des pathologies complexes nécessitant parfois un plateau technique de pointe (chirurgie, imagerie de haute précision, cancérologie).
- Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire (chirurgiens, anesthésistes, infirmiers spécialisés, kinésithérapeutes) et coordonner les parcours de soins.
- Bénéficier d’un cadre organisationnel facilitant : secrétariat centralisé, gestion logistique et administrative assurée par l’établissement, ce qui libère du temps médical.
- S’adapter à des contrats variés : salariat, contrat d’association, ou vacations rémunérées.
🔎 Perspectives et évolutions possibles
Un médecin dans le privé peut :
- Se spécialiser davantage grâce à des formations complémentaires (oncologie, cardiologie interventionnelle, chirurgie spécialisée, anesthésie-réanimation).
- Participer à des programmes de recherche clinique souvent financés par des partenariats entre établissements privés et laboratoires pharmaceutiques.
- Évoluer vers des postes de coordination ou de direction médicale, en assurant la gestion des services et la supervision d’équipes.
- Développer une activité mixte combinant cabinet libéral et clinique privée, permettant de diversifier les revenus et les expériences professionnelles.
👉 Exercer dans le secteur privé offre un cadre moderne, une grande diversité de cas et souvent de meilleures conditions matérielles. C’est une voie prisée pour les médecins qui veulent conjuguer expertise clinique, stabilité et opportunités de carrière évolutives.
Le médecin dans le secteur public
📚 Un pilier du système de santé français
Le métier de médecin dans le secteur public s’exerce principalement dans les hôpitaux publics, les centres hospitaliers universitaires (CHU) et d’autres établissements de santé dépendant de l’État. Ce choix attire les praticiens qui souhaitent participer à une mission de service public, combinant soins, recherche et enseignement. 👉 Travailler dans le public permet d’accéder à des cas cliniques très variés, parfois rares ou complexes, tout en contribuant à la formation des étudiants et internes en médecine.
👩🔬 Les étapes de la formation en lien avec le secteur public
- Externat (4ᵉ à 6ᵉ année) : la majorité des stages sont réalisés dans des services hospitaliers publics, ce qui familiarise les étudiants avec l’organisation et les réalités du terrain (urgences, médecine interne, spécialités chirurgicales, etc.).
- Internat (3ᵉ cycle) : les internes effectuent la totalité ou une grande partie de leurs stages dans des établissements publics. 👉 Ils y acquièrent une expertise clinique, apprennent à gérer des pathologies lourdes et participent activement aux gardes et astreintes.
- Post-internat : une fois la thèse validée, le médecin peut être recruté comme praticien hospitalier contractuel (PHC), praticien hospitalier (PH) après concours, ou encore maître de conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH) s’il souhaite combiner soins et enseignement.
🎓 Compétences et réalités du métier
Le médecin du secteur public développe des compétences variées et approfondies :
- Prendre en charge des urgences médicales et chirurgicales souvent complexes, dans un environnement technique de pointe.
- Assurer le suivi des patients chroniques et la gestion de pathologies rares nécessitant une expertise hospitalo-universitaire.
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et participer à des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) pour établir des stratégies thérapeutiques.
- Contribuer à la recherche clinique et translationnelle, en collaboration avec des laboratoires universitaires ou privés.
- Former les futurs médecins (externes, internes, étudiants en santé) par l’encadrement, les cours et la participation aux travaux universitaires.
🔎 Perspectives et évolutions possibles
Un médecin dans le secteur public peut :
- Évoluer vers des postes de chef de service ou de coordinateur médical au sein de l’hôpital.
- Participer à des programmes de recherche nationaux ou internationaux, en particulier dans les CHU.
- Combiner activité hospitalière et enseignement universitaire, en devenant MCU-PH ou PU-PH (Professeur des Universités-Praticien Hospitalier).
- S’engager dans des missions de santé publique : prévention, épidémiologie, expertise auprès des agences régionales de santé (ARS).
👉 Exercer dans le secteur public, c’est choisir une voie exigeante mais prestigieuse, offrant un rôle central dans la prise en charge de la population, la transmission des savoirs et l’avancée des connaissances médicales.
Le médecin en vacation
📚 Une modalité d’exercice flexible et diversifiée
Le métier de médecin en vacation consiste à travailler de manière ponctuelle ou régulière dans une ou plusieurs structures de soins (hôpitaux, cliniques privées, centres de santé, établissements médico-sociaux). 👉 Cette forme d’exercice séduit de nombreux praticiens car elle offre une grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail, tout en permettant d’explorer différents environnements cliniques et d’élargir son champ de compétences.
👩🔬 Les étapes de la formation en lien avec la pratique en vacation
- Externat : les étudiants découvrent déjà la diversité des structures médicales (hôpitaux généraux, CHU, cliniques privées), ce qui leur donne une première idée des modalités d’exercice à temps partiel ou en vacation.
- Internat : certains internes choisissent de réaliser des vacations complémentaires, notamment dans des cliniques privées ou centres spécialisés, pour diversifier leurs expériences.
- Après la thèse : les jeunes médecins peuvent signer des contrats de vacations avec des établissements, en complément ou en alternative à un poste hospitalier ou libéral. 👉 Cette flexibilité facilite aussi l’installation progressive, en parallèle de missions ponctuelles.
🎓 Compétences et réalités du métier
Le médecin en vacation développe des atouts spécifiques :
- Adapter sa pratique à différents contextes cliniques, en passant d’une structure hospitalière à une clinique ou à un centre de soins spécialisé.
- Gérer des patients variés selon le lieu d’exercice : urgences hospitalières, suivi en centre de santé, interventions ponctuelles en gériatrie ou en pédiatrie.
- Maintenir une polyvalence médicale, souvent enrichie par la confrontation à des organisations et pratiques professionnelles différentes.
- Développer une capacité d’adaptation rapide et une autonomie dans la gestion de situations diverses.
🔎 Perspectives et évolutions possibles
Un médecin en vacation peut :
- Compléter une activité libérale ou hospitalière par des vacations dans d’autres établissements, pour élargir son expérience et diversifier ses revenus.
- S’orienter progressivement vers un poste hospitalier ou privé à temps plein, après une phase de découverte par vacations.
- Participer à des missions spécifiques, par exemple en médecine scolaire, en médecine du travail ou en santé publique.
- Développer une expertise dans des domaines précis grâce à des vacations régulières dans des services spécialisés (oncologie, réanimation, chirurgie ambulatoire).
👉 L’exercice en vacation est une voie souple et enrichissante, permettant au médecin de concilier liberté, diversité de pratique et équilibre personnel, tout en restant pleinement impliqué dans la prise en charge des patients.
Les spécialités en Médecine
En France il existe 44 spécialités dont 28 disciplines médicales et 13 disciplines chirurgicales.
Les spécialités médicales
Les spécialités chirurgicales
- Allergologie
- Anatomie et cytologie pathologique
- Anesthésie
- Cardiologie
- Dermatologie
- Endocrinologie-nutrition
- Génétique
- Gériatrie
- Gynécologie médicale
- Hématologie
- Hépato-gastro-entérologie
- Maladies infectieuses et tropicales
- Médecine du travail
- Médecine générale
- Médecine interne
- Médecine nucléaire
- Médecine physique et réadaptation
- Néphrologie
- Neurologie
- Oncologie
- Pédiatrie
- Pneumologie
- Psychiatrie
- Radiologie
- Réanimation
- Rhumatologie
- Santé publique
- Urgentiste
- Chirurgie esthétique
- Chirurgie maxillo-facial-stomatologie
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie vasculaire
- Chirurgie viscérale et digestive
- Gynécologie obstétrique
- Médecine légale et expertise
- Neurochirurgie
- Ophtalmologiste
- ORL (oto-rhino-laryngologie) et chirurgie cervico-faciale
- Orthopédie
- Urologie
Faut-il choisir PASS ou L.AS pour étudier en étude de Médecine ? Découvre-le en faisant le Test PASS/LAS !
Fais notre Test d’Orientation Parcoursup pour découvrir un cursus paramédical fait pour toi !
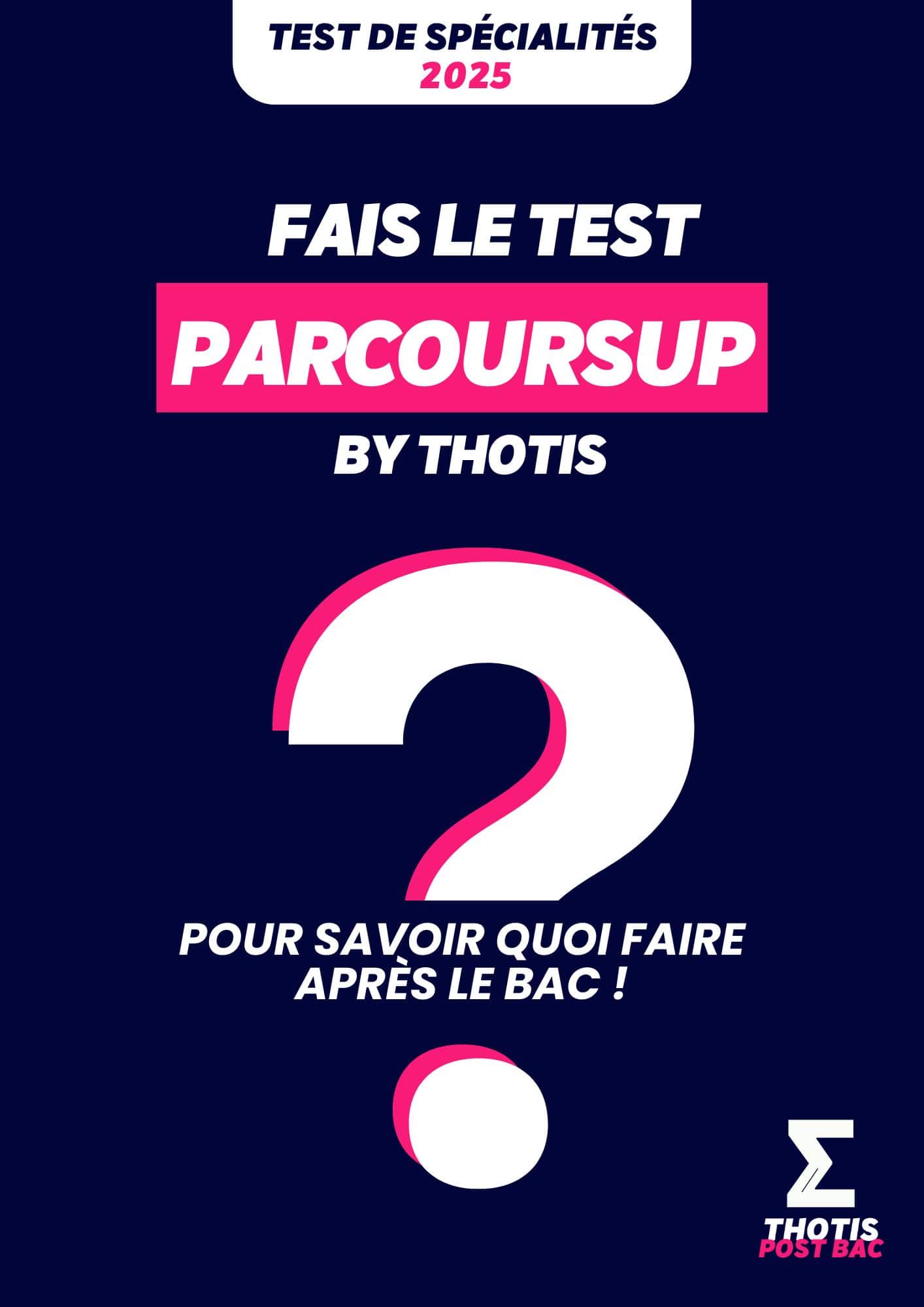
TROUVE TA VOIE
Thotis, LE média de référence pour aider les jeunes dans leurs choix d’orientation, du lycée à l’insertion professionnelle.
Chiffres clés
📍 Thotis : leader de l’orientation digitale en France
Thotis est un média digital et gratuit, imaginé par des jeunes pour accompagner les lycéens et les étudiants dans leurs choix d’orientation.
Depuis 2018, nous travaillons à rendre les formations plus lisibles et compréhensibles, en aidant chaque jeune à trouver sa voie. Pour cela, nous proposons des contenus modernes et variés : témoignages d’étudiants, immersions vidéo dans les universités et écoles, des infographies impactantes sur les réseaux sociaux et des intelligences artificielles d’orientation.
Pas besoin d’être expert pour s’y retrouver : nous expliquons les parcours, donnons la parole à ceux qui les vivent, et facilitons l’accès à une information claire et authentique.
Thotis est conventionné et travaille en partenariat avec les équipes nationales de Parcoursup, de Mon Master, les universités publiques (réunies au sein de France Universités), ainsi qu’avec les associations de professeurs de CPGE (APHEC, APPLS, UPS, UPA et UPSTI) et les associations de proviseurs (APLCPGE).