Accueil > Post Bac > Orientation > Les études et écoles vétérinaires
Les études et Écoles vétérinaires
Les études et écoles vétérinaires forment au métier de docteur vétérinaire en 6 à 7 ans après le baccalauréat. Le cursus se déroule majoritairement dans les Écoles Nationales Vétérinaires (ENV) — établissements publics sélectifs — ainsi que dans une école privée.
Plusieurs voies d’accès coexistent : une admission post-bac via Parcoursup (voie sélective spécifique aux ENV), l’accès après une CPGE BCPST, mais aussi après Licence (L2/L3), BUT ou BTSA selon des concours dédiés. Chaque voie combine des attendus forts en sciences du vivant (biologie, chimie, mathématiques) et une solide motivation pour la santé animale et le bien-être animal.
Le cursus en école alterne enseignements scientifiques, pratiques cliniques et stages (cliniques, élevages, industrie, santé publique), jusqu’à la thèse d’exercice. Les diplômés exercent en cliniques ou cabinets, dans les élevages, l’agro-alimentaire, la recherche ou la santé publique vétérinaire.
Pourquoi choisir les études vétérinaires ? Quelles voies d’accès (post-bac, prépa BCPST, Licence, BUT/BTSA) ? Comment se déroule la formation en ENV et quelles perspectives après le diplôme ?
Les principales voies d’accès aux études vétérinaires :
- La voie CPGE BCPST : destinée aux bacheliers généraux passionnés par les sciences du vivant (biologie, chimie, mathématiques). C’est la voie historique et la plus représentée pour intégrer les Écoles Nationales Vétérinaires (ENV).
- La voie universitaire : accessible après une Licence scientifique (biologie, sciences de la vie, chimie, etc.). Elle permet de présenter le concours vétérinaire en L2 ou L3, avec un profil plus académique et orienté recherche.
- La voie technologique (BUT / BTSA) : ouverte aux étudiants issus de formations comme le BTSA Productions animales, BTSA Anabiotech ou certains BUT scientifiques. Elle combine formation technique et scientifique avant l’intégration en école vétérinaire.
- L’admission post-bac directe : depuis 2021, une partie des places en ENV est ouverte via Parcoursup pour les bacheliers généraux ayant suivi un parcours solide en mathématiques, physique-chimie et SVT.
Au programme en école vétérinaire (ENV) :
Les Écoles Nationales Vétérinaires proposent un cursus professionnalisant et progressif centré sur la santé animale, la médecine et chirurgie, le bien-être et la santé publique vétérinaire.
Avec environ 30 à 35 heures de formation hebdomadaire, le programme s’articule généralement en trois cycles :
- Cycle 1 – Sciences fondamentales & bases professionnelles : anatomie, physiologie, histologie, biochimie, microbiologie, parasitologie…
- Cycle 2 – Médecine & pathologies : sémiologie, imagerie, anesthésie-analgésie, médecine interne, reproduction, maladies infectieuses…
- Cycle 3 – Rotations cliniques & pré-professionnalisation : prise en charge de patients en hôpital vétérinaire universitaire (animaux de compagnie, équins, animaux de production, NAC), chirurgie, consultations spécialisées…
Stages obligatoires tout au long du cursus :
- Stages cliniques en cabinets/clinique et services hospitaliers des ENV.
- Stages en élevage et en filière agroalimentaire (suivi sanitaire, biosécurité, qualité des denrées).
- Immersions en santé publique (abattoir, contrôle officiel, sécurité sanitaire des aliments).
- Possibilité de stage recherche (laboratoires, unités INRAE/INSERM/Université).
En fin de cursus, l’étudiant valide les unités d’enseignement menant aux études fondamentales vétérinaires (DEFV/CEFV selon établissement), puis prépare la thèse d’exercice conduisant au titre de docteur vétérinaire. Des parcours de spécialisation (internat, résidanat, masters/DU) sont accessibles selon le projet : animaux de compagnie, équine, animaux de production, santé publique, imagerie, chirurgie, médecine interne, etc.
Comprendre les parcours : ENV, prépa BCPST et université
Besoin d’aide pour choisir entre une ENV (école vétérinaire), la prépa BCPST ou une Licence à l’université ? Voici un aperçu clair et synthétique pour comparer leurs objectifs, leurs modalités d’admission, le rythme de travail et les débouchés vers le diplôme de vétérinaire et les métiers du soin animalier.
CPGE BCPST vs ENV : quelles différences dans l’accès aux études vétérinaires ?
La prépa BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre) est la voie d’accès la plus classique pour intégrer une École Nationale Vétérinaire (ENV). Elle dure 2 ans et prépare aux concours vétérinaires à travers un enseignement scientifique intensif.
À l’inverse, l’ENV n’est pas une prépa mais bien une école d’application en 5 ans où les étudiants suivent directement une formation professionnalisante pour devenir vétérinaire.
En résumé, la BCPST est la porte d’entrée vers les ENV, tandis que l’ENV correspond à la formation cœur de métier.
École vétérinaire (ENV) vs École d’ingénieurs agronomes : quels débouchés et quelles missions ?
Les écoles vétérinaires forment des praticiens capables de soigner les animaux, de travailler en clinique, en santé publique ou en recherche biomédicale. Leur mission principale est la santé animale et la sécurité sanitaire.
Les écoles d’ingénieurs agronomes, quant à elles, préparent à des métiers liés à la production agricole, à l’environnement et à l’agroalimentaire.
En résumé, le vétérinaire soigne tandis que l’ingénieur agronome conçoit et optimise des systèmes de production et de gestion des ressources.
ENV vs Faculté de médecine : quelles similitudes et différences dans la formation scientifique ?
Les deux cursus reposent sur une base solide de sciences fondamentales (biologie, physiologie, anatomie).
En médecine humaine, la formation se concentre sur la santé et le soin des patients humains, avec un long tronc commun avant de se spécialiser.
En école vétérinaire, le spectre est plus large : les étudiants étudient la santé des animaux domestiques, d’élevage et de la faune, avec des volets en zootechnie et en santé publique.
Les deux métiers partagent une approche scientifique rigoureuse mais leurs applications diffèrent : soigner l’homme vs soigner les animaux et protéger la santé publique.
Suis-je fait pour étudier en école vétérinaire ?
Es-tu fait pour les études vétérinaires ? Fais notre Test d’Orientation Parcoursup, c’est gratuit évidemment !
École vétérinaire (ENV) vs Licence Sciences de la Vie : quel parcours privilégier après le bac ?
Une Licence Sciences de la Vie se déroule à l’université en 3 ans. Elle propose un enseignement plus théorique et académique, axé sur la biologie, la chimie et la physiologie. Elle peut mener à un master et ouvrir vers la recherche, l’enseignement ou des concours passerelles vers les écoles vétérinaires.
L’ENV, en revanche, est directement une formation professionnalisante de vétérinaire, avec des stages, de la pratique clinique et un objectif clair : exercer le métier.
La licence est donc une voie de réorientation ou d’accès différé, tandis que l’ENV correspond à la formation métier directe.
Métiers vétérinaires vs Métiers de la santé animale (ASV, soigneur animalier, éducateur) : quelles responsabilités et quelles formations ?
Le vétérinaire est un médecin des animaux, habilité à diagnostiquer, prescrire et opérer. Il suit 7 ans d’études et porte une responsabilité légale en matière de santé publique et animale.
Les ASV (Auxiliaires Spécialisés Vétérinaires), soigneurs animaliers ou éducateurs canins ont un rôle essentiel d’accompagnement, de soins de confort, de suivi quotidien ou de dressage, mais sans actes médicaux.
Ces formations sont plus courtes (Bac pro, BTS, écoles spécialisées) et mènent à des métiers complémentaires mais différents.
En résumé, le vétérinaire est un décideur médical, tandis que les autres professionnels assurent un soutien essentiel au bien-être animal.
Études vétérinaires en France vs Études vétérinaires à l’étranger : quelles spécificités ?
En France, les études vétérinaires sont structurées autour des ENV (Maisons-Alfort, Lyon, Toulouse, Nantes) et accessibles via concours après prépa ou admissions parallèles. Elles durent 5 à 7 ans selon les spécialisations.
À l’étranger, les modalités varient fortement : dans certains pays (Espagne, Belgique, Roumanie), les études sont accessibles directement après le bac.
Les frais de scolarité sont souvent plus élevés à l’étranger, mais ces cursus attirent de nombreux étudiants français.
En résumé, la France privilégie la sélectivité et l’excellence académique, alors que certains pays européens offrent un accès plus direct.
Les études vétérinaires en vidéo : immersion avec une étudiante
Questions fréquentes sur les écoles nationales vétérinaires (ENV) :
Tu veux en savoir plus sur les études vétérinaires et les ENV ? On t’explique tout ce qu’il faut connaître : conditions d’admission et concours, choix des spécialités au lycée, organisation et durée du cursus, vie étudiante et pratique clinique en écoles vétérinaires, rôle des stages et de la thèse d’exercice, sans oublier les opportunités de mobilité internationale et les modalités d’inscription via Parcoursup…
Quelles sont les écoles vétérinaires (ENV) en France et où sont-elles situées ?
La France compte 4 ENV publiques et 1 établissement privé habilité :
- École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) – Maisons-Alfort (Île-de-France)
- VetAgro Sup – campus vétérinaire de Lyon
- Oniris – Nantes (pôle vétérinaire)
- ENVT – Toulouse
- UniLaSalle Rouen (privé, cursus vétérinaire habilité)
Pour repérer les capacités d’accueil et modalités, consultez l’annuaire des écoles vétérinaires et notre classement Thotis.
Études vétérinaires : quelles voies d’accès aux ENV et comment candidater ?
Il existe plusieurs portes d’entrée vers les ENV (écoles nationales vétérinaires) et l’école privée habilitée :
- Concours post-bac via Parcoursup : dossier + épreuves spécifiques selon le calendrier Parcoursup. Idéal pour les bacheliers généraux à forte appétence scientifique.
- Après BCPST/ATS/licence : admissions sur concours dédiés en fonction du premier cycle suivi (biologie, chimie, sciences du vivant…).
- Après BTSA/BUT “bio” : voies d’admission spécifiques (souvent avec une mise à niveau scientifique ou une prépa ATS biologie recommandée).
À faire concrètement : créer son dossier sur Parcoursup, sélectionner la voie d’accès adaptée, respecter les échéances (vœux, confirmations, épreuves) et préparer les pièces demandées (bulletins, projet motivé, justificatifs).
Ressources utiles : guide “Écoles vétérinaires”, annuaire des écoles vétérinaires.
ENV : quel bac et quelles spécialités choisir au lycée pour les études vétérinaires ?
Pour maximiser vos chances d’intégrer des études vétérinaires, privilégiez un baccalauréat général avec des spécialités scientifiques :
- SVT (recommandé) pour la biologie et les sciences du vivant ;
- Physique-chimie pour les bases expérimentales ;
- Mathématiques ou maths complémentaires selon votre profil.
Des options comme NSI ou Sciences de l’ingénieur peuvent compléter le dossier. Au-delà des matières, les jurys regardent la régularité des résultats, les appréciations et la motivation démontrée dans le projet de formation.
Concours post-bac des écoles vétérinaires : comment ça marche (ENV & épreuves) ?
Le concours post-bac vers les écoles vétérinaires se déroule via Parcoursup et comporte :
- Un dossier académique (notes de première/terminale, spécialités, appréciations),
- Des épreuves/ateliers selon la voie d’accès (tests de connaissances, mise en situation, entretien),
- Un calendrier précis (vœux, confirmations, convocations, résultats).
Conseils : anticipez la préparation scientifique (SVT, physique-chimie, maths), entraînez-vous à présenter votre projet (motivation, compréhension du métier, réalité de la formation) et respectez toutes les échéances.
Études vétérinaires : quelle durée et quel déroulé du cursus en ENV ?
Le cursus en ENV dure en général 6 ans après le bac, organisé en cycles progressifs :
- Cycle pré-clinique : sciences fondamentales (anatomie, physiologie, microbiologie, pharmacologie) et premiers travaux pratiques.
- Cycle clinique : rotation dans les cliniques universitaires (animaux de compagnie, élevages, équins, NAC), urgences, imagerie, chirurgie, médecine interne, santé publique vétérinaire.
- Année de consolidation : stages longs, approfondissements, préparation de la thèse d’exercice.
La formation associe cours, TP/TD, garde/astreintes en clinique, stages en milieu professionnel et un mémoire/thèse soutenu en fin de parcours.
Écoles vétérinaires : quels frais de scolarité (ENV publiques vs privé) et quelles aides ?
« `html
ENV publiques : droits de scolarité de l’enseignement supérieur public (droits nationaux annuels) + CVEC. Les boursiers peuvent être exonérés selon leur échelon. Des aides régionales/étudiantes peuvent compléter (logement, mobilité, restauration).
Établissement privé habilité : frais plus élevés, publiés chaque année par l’école (souvent différenciés selon les années d’études). Des facilités de paiement et bourses internes peuvent exister.
À vérifier avant de candidater : montant par année, coûts additionnels (assurances, équipement, blouses, déplacements en stage), dispositifs d’aides et conditions d’éligibilité.
ENV : quelle place pour la pratique clinique et les stages durant les études vétérinaires ?
La pratique clinique est au cœur des études vétérinaires. Dès le cycle clinique, vous alternez :
- Rotations en cliniques universitaires : médecine préventive, consultations, chirurgie, imagerie, anesthésie-réanimation, urgences.
- Stages en milieux variés : cliniques libérales, élevages, centres hospitaliers, laboratoires, structures de santé animale et de santé publique.
- Garde/astreintes supervisées : prise en charge de cas réels, travail en équipe, transmissions.
Objectif : développer autonomie, raisonnement clinique et gestes techniques en conditions réelles.
Diplôme des écoles vétérinaires : quel titre obtient-on et qu’est-ce que la thèse d’exercice ?
À l’issue de la formation, l’étudiant soutient une thèse d’exercice vétérinaire portant sur un sujet clinique, scientifique ou de santé publique. Cette soutenance permet l’obtention du diplôme d’État de docteur vétérinaire.
La thèse comporte généralement une revue de littérature, une partie expérimentale/clinique (ou cas cliniques documentés) et une discussion mettant en perspective les résultats. Après validation, l’inscription à l’Ordre est possible selon la réglementation en vigueur.
Études vétérinaires et international : quelles possibilités de mobilité (échanges, stages, externats) ?
Les écoles vétérinaires proposent des mobilités internationales :
- Échanges académiques d’un semestre ou d’une année dans des facultés partenaires ;
- Stages cliniques ou de recherche à l’étranger (cliniques universitaires, laboratoires, ONG) ;
- Projets en santé animale/santé publique dans une logique One Health.
À anticiper : niveau de langue, assurances, visa, reconnaissance des activités pour la validation des UE et des ECTS.
Parcoursup & ENV : quel calendrier d’inscription et quelles pièces préparer ?
Le calendrier suit les étapes clés de Parcoursup :
- Janv.–Mars : formulation des vœux (ENV/voie d’accès),
- Mars–Avril : finalisation des dossiers et projets motivés,
- Avril–Mai : convocations et épreuves/ateliers selon la voie,
- Fin Mai–Juillet : phase d’admission et réponses (oui/attente).
Pièces à anticiper : bulletins et relevés, pièces d’identité, justificatifs spécifiques (certificats, attestations de stage/engagement), CV éventuel, éléments logistiques (tiers temps, aménagements), et lettres de motivation adaptées.
Tu veux en savoir plus sur les études vétérinaires et leurs débouchés ? On t’explique tout ce qu’il faut connaître !
Le vétérinaire en clinique
Missions et cadre d’exercice en clinique
Le vétérinaire en clinique prend en charge principalement les animaux de compagnie (chiens, chats) et, selon la structure, les NAC (nouveaux animaux de compagnie : lapins, furets, oiseaux, reptiles). Il assure la médecine préventive (vaccinations, bilans), le diagnostic (examen clinique, imagerie, analyses), la thérapeutique (médicale et chirurgicale) et le suivi des patients. L’activité combine expertise clinique, relation de confiance avec les propriétaires et organisation d’une structure de soins (planning, hygiène, traçabilité). Les cliniques sont de tailles variées : cabinet de proximité, clinique pluridisciplinaire, hôpital vétérinaire. L’exercice peut être salarié ou libéral/associé, au sein d’équipes comprenant des ASV (auxiliaires spécialisés vétérinaires) et parfois des vétérinaires spécialisés (imagerie, ophtalmologie, cardiologie, dermatologie, dentisterie, NAC…).
Organisation du travail et journée type
- Consultations : motifs préventifs (vaccins, identification, conseils nutrition/éducation), maladies aiguës/chroniques, endocrinologie, dermatologie, gériatrie.
- Chirurgie : actes courants (stérilisations, dentisterie, tissus mous) et, selon l’équipement/compétences, orthopédie ou endoscopie. Gestion de la douleur et protocoles d’anesthésie/analgésie.
- Imagerie et analyses : radiographie, échographie, parfois scanner/IRM en référé ; hémato-biochimie, cytologie, tests rapides au chevet du patient.
- Hospitalisation : surveillance, perfusions, nutrition, nursing, fiches de soins et compte-rendus aux propriétaires.
- Urgences et gardes : tri, stabilisation, réanimation de base, référé si nécessaire. Organisation d’un service d’astreinte selon la zone.
- Hygiène, biosécurité, traçabilité : protocoles de nettoyage/désinfection, gestion des déchets d’activités de soins, pharmacovigilance.
- Gestion & communication : dossiers médicaux informatisés, devis et consentement éclairé, suivi post-opératoire, coordination d’équipe.
Compétences indispensables
- Diagnostic clinique : examen rigoureux, raisonnement médical, choix d’examens complémentaires pertinents.
- Techniques médico-chirurgicales : gestes aseptiques, anesthésie sécurisée, suture, soins dentaires, imagerie.
- Relation et pédagogie : écoute, explication des options thérapeutiques, accompagnement des décisions (pronostic, qualité de vie).
- Gestion et organisation : planification, priorisation des cas, travail en équipe avec les ASV et confrères.
- Éthique & bien-être animal : douleur, contention raisonnée, prévention des risques, décisions proportionnées.
- Culture numérique : logiciels métiers, imagerie numérique, télé-expertise/référé, respect RGPD pour la donnée client.
Pendant les études : ce qui prépare à la clinique
- Rotations cliniques en hôpitaux universitaires : médecine interne, chirurgie, urgences, imagerie, anesthésie, NAC, reproduction.
- Gardes encadrées : prise en charge initiale des urgences, stabilisation, communication avec les propriétaires, dossiers.
- Responsabilités progressives : de l’observation au case management supervisé ; rédaction d’ordonnances et de comptes rendus.
- Stages en structures privées : immersion dans l’organisation réelle d’une clinique, relation client, facturation et logistique.
- Compétences transversales : anesthésie/analgésie, gestion de la douleur, antibiogouvernance, prévention et santé publique vétérinaire.
Évolutions de carrière en clinique
- Parcours d’association/installation : reprise ou création de structure, gestion d’équipe et du plateau technique.
- Hyper-compétence en clinique générale : médecine interne, gériatrie, douleur, dentisterie, nutrition, comportement.
- Spécialisations (diplômes complémentaires) : imagerie, ophtalmologie, cardiologie, NAC, dermatologie, orthopédie… avec exercice de référé.
- Encadrement & formation : tutorat d’étudiants/ASV, formation continue, implication dans des réseaux de cliniques.
En bref : la clinique vétérinaire offre un exercice polyvalent, concret et relationnel, au cœur de la médecine des animaux de compagnie. C’est un cadre exigeant mais stimulant, qui valorise autant la qualité des soins que l’accompagnement des propriétaires et le travail d’équipe.
Le vétérinaire en recherche et développement
Un rôle clé dans l’innovation médicale et scientifique
Le vétérinaire en recherche et développement participe activement à l’avancée des connaissances scientifiques et au développement de nouvelles approches pour améliorer la santé animale – et parfois humaine, dans le cadre de la santé publique et du concept One Health. Son activité couvre la compréhension des maladies, la mise au point de traitements innovants, de vaccins, de tests diagnostiques et de solutions thérapeutiques plus sûres et plus efficaces. Il exerce au sein d’équipes pluridisciplinaires dans des laboratoires publics (INRAE, CNRS, universités) ou privés (industrie pharmaceutique, biotechnologies, nutrition animale).
Domaines d’intervention
- Recherche fondamentale : étude de la biologie, de la génétique et de l’immunologie animale pour comprendre les mécanismes des maladies infectieuses, parasitaires, cancéreuses ou métaboliques.
- Recherche appliquée : développement de vaccins, d’antibiotiques alternatifs, d’anti-inflammatoires, de thérapies géniques ou de probiotiques adaptés aux animaux de compagnie et d’élevage.
- Santé publique : surveillance des zoonoses (maladies transmissibles à l’homme), épidémiologie, études de résistance aux antimicrobiens.
- Innovation technologique : conception de nouveaux outils de diagnostic (tests rapides, imagerie), systèmes connectés de suivi de santé animale, solutions d’intelligence artificielle pour la médecine vétérinaire.
Compétences nécessaires
- Maîtriser la méthodologie scientifique : protocole expérimental, collecte et analyse des données, validation des résultats.
- Connaître la réglementation en matière d’expérimentation animale et les normes éthiques de la recherche.
- Développer des compétences en biostatistiques et en analyse informatique pour interpréter des ensembles de données complexes.
- Savoir communiquer : publications scientifiques, participation à des congrès, vulgarisation auprès des professionnels et décideurs.
- Travailler en collaboration internationale dans un contexte d’équipes multiculturelles et multidisciplinaires.
Durant les études vétérinaires
- Modules spécialisés : infectiologie, parasitologie, immunologie, pharmacologie, épidémiologie.
- Stages en laboratoires universitaires ou en entreprises pharmaceutiques pour initier les étudiants à la recherche appliquée.
- Mémoires ou thèses d’exercice centrés sur des thématiques scientifiques ou expérimentales.
- Possibilité d’intégrer un doctorat en sciences après le diplôme vétérinaire pour approfondir une spécialisation scientifique.
Évolutions professionnelles
- Chercheur dans un institut public ou un laboratoire universitaire.
- Responsable R&D dans une entreprise pharmaceutique ou de biotechnologies.
- Expert en santé publique et épidémiologie pour des organismes nationaux ou internationaux (ANSES, OMSA, FAO, OMS).
- Enseignant-chercheur en école vétérinaire ou en faculté de sciences, combinant enseignement et recherche.
En bref : la recherche et développement offre au vétérinaire une carrière scientifique, innovante et tournée vers l’avenir. C’est une voie exigeante qui demande rigueur, curiosité et esprit critique, mais qui permet d’avoir un impact concret sur la santé animale, humaine et environnementale.
Le vétérinaire en recherche et développement
Un rôle clé dans l’innovation médicale et scientifique
Le vétérinaire en recherche et développement participe activement à l’avancée des connaissances scientifiques et au développement de nouvelles approches pour améliorer la santé animale – et parfois humaine, dans le cadre de la santé publique et du concept One Health. Son activité couvre la compréhension des maladies, la mise au point de traitements innovants, de vaccins, de tests diagnostiques et de solutions thérapeutiques plus sûres et plus efficaces. Il exerce au sein d’équipes pluridisciplinaires dans des laboratoires publics (INRAE, CNRS, universités) ou privés (industrie pharmaceutique, biotechnologies, nutrition animale).
Domaines d’intervention
- Recherche fondamentale : étude de la biologie, de la génétique et de l’immunologie animale pour comprendre les mécanismes des maladies infectieuses, parasitaires, cancéreuses ou métaboliques.
- Recherche appliquée : développement de vaccins, d’antibiotiques alternatifs, d’anti-inflammatoires, de thérapies géniques ou de probiotiques adaptés aux animaux de compagnie et d’élevage.
- Santé publique : surveillance des zoonoses (maladies transmissibles à l’homme), épidémiologie, études de résistance aux antimicrobiens.
- Innovation technologique : conception de nouveaux outils de diagnostic (tests rapides, imagerie), systèmes connectés de suivi de santé animale, solutions d’intelligence artificielle pour la médecine vétérinaire.
Compétences nécessaires
- Maîtriser la méthodologie scientifique : protocole expérimental, collecte et analyse des données, validation des résultats.
- Connaître la réglementation en matière d’expérimentation animale et les normes éthiques de la recherche.
- Développer des compétences en biostatistiques et en analyse informatique pour interpréter des ensembles de données complexes.
- Savoir communiquer : publications scientifiques, participation à des congrès, vulgarisation auprès des professionnels et décideurs.
- Travailler en collaboration internationale dans un contexte d’équipes multiculturelles et multidisciplinaires.
Durant les études vétérinaires
- Modules spécialisés : infectiologie, parasitologie, immunologie, pharmacologie, épidémiologie.
- Stages en laboratoires universitaires ou en entreprises pharmaceutiques pour initier les étudiants à la recherche appliquée.
- Mémoires ou thèses d’exercice centrés sur des thématiques scientifiques ou expérimentales.
- Possibilité d’intégrer un doctorat en sciences après le diplôme vétérinaire pour approfondir une spécialisation scientifique.
Évolutions professionnelles
- Chercheur dans un institut public ou un laboratoire universitaire.
- Responsable R&D dans une entreprise pharmaceutique ou de biotechnologies.
- Expert en santé publique et épidémiologie pour des organismes nationaux ou internationaux (ANSES, OMSA, FAO, OMS).
- Enseignant-chercheur en école vétérinaire ou en faculté de sciences, combinant enseignement et recherche.
En bref : la recherche et développement offre au vétérinaire une carrière scientifique, innovante et tournée vers l’avenir. C’est une voie exigeante qui demande rigueur, curiosité et esprit critique, mais qui permet d’avoir un impact concret sur la santé animale, humaine et environnementale.
Le vétérinaire dans les organismes de protection des animaux
Un rôle engagé pour le bien-être animal
Le vétérinaire travaillant dans des organismes de protection des animaux consacre son expertise à la prévention de la maltraitance, à la promotion du bien-être animal et à la mise en œuvre de politiques publiques liées à la condition animale. Il peut intervenir dans des structures variées : associations de protection (SPA, fondations), refuges, ONG internationales ou encore organismes publics en charge de la surveillance et du respect de la législation.
Missions principales
- Suivi sanitaire et soins : assurer les soins vétérinaires des animaux recueillis (vaccination, stérilisation, traitements des maladies ou blessures).
- Contrôles et inspections : participer aux enquêtes en cas de suspicion de maltraitance, effectuer des constats sanitaires et apporter une expertise médicale.
- Prévention et sensibilisation : concevoir et animer des campagnes éducatives sur la protection animale et le respect des lois.
- Conseil juridique et technique : accompagner les collectivités et les associations dans l’application de la réglementation sur la faune domestique ou sauvage.
Compétences nécessaires
- Expertise en médecine animale générale, adaptée aux chiens, chats, NAC ou animaux de ferme recueillis.
- Bonne maîtrise de la réglementation nationale et européenne sur la protection animale.
- Capacités de médiation et communication avec le public, les associations et les autorités.
- Sens de l’éthique et engagement fort envers le bien-être animal.
Durant les études vétérinaires
- Enseignements en éthique et législation animale intégrés au cursus.
- Stages dans des refuges ou associations pour développer une expérience de terrain sur les problématiques de protection animale.
- Projets tutorés portant sur la gestion des populations animales, la maltraitance et les actions de sensibilisation.
Évolutions professionnelles
- Vétérinaire responsable sanitaire dans un refuge ou une association nationale.
- Chargé de mission en protection animale pour une collectivité territoriale ou une ONG internationale.
- Inspecteur vétérinaire dans l’administration publique, chargé de veiller au respect des réglementations.
- Expert auprès des tribunaux dans les affaires de maltraitance animale.
En résumé : le vétérinaire dans les organismes de protection animale combine pratique médicale, expertise juridique et engagement éthique. C’est une voie qui attire les professionnels sensibles aux enjeux de société et au respect du bien-être animal.
Le vétérinaire dans l’industrie agroalimentaire
Un rôle clé pour la sécurité alimentaire
Le vétérinaire dans l’industrie agroalimentaire veille à la qualité sanitaire des denrées d’origine animale (viande, lait, œufs, poissons, etc.). Son expertise permet d’assurer la sécurité alimentaire, de respecter les normes européennes et internationales et de protéger la santé publique. Il intervient à chaque étape : de l’élevage à l’abattage, en passant par la transformation et la distribution.
Missions principales
- Contrôles sanitaires : vérifier les conditions d’abattage, d’hygiène et de traçabilité des produits.
- Audits et certifications : garantir que les entreprises respectent les normes de sécurité alimentaire (HACCP, ISO, normes européennes).
- Recherche et innovation : participer au développement de nouvelles méthodes de conservation, d’emballage ou de transformation des aliments.
- Formation et conseil : accompagner les industriels dans la mise en place de protocoles sanitaires et former les équipes à leur application.
Compétences nécessaires
- Maîtrise des réglementations sanitaires nationales et européennes.
- Capacités en analyse des risques et en gestion de crise sanitaire (épidémies, contaminations).
- Connaissances en microbiologie, hygiène alimentaire et sécurité des procédés.
- Esprit d’analyse et rigueur scientifique.
Durant les études vétérinaires
- Enseignements en santé publique vétérinaire, hygiène alimentaire et épidémiologie.
- Stages en abattoirs, laboratoires ou industries agroalimentaires pour acquérir une expérience pratique.
- Possibilité de spécialisation via des masters en santé publique, qualité alimentaire ou sécurité sanitaire des aliments.
Évolutions professionnelles
- Inspecteur vétérinaire dans l’administration (DGAL, services vétérinaires européens).
- Responsable qualité ou responsable hygiène dans une entreprise agroalimentaire.
- Expert en sécurité sanitaire pour des organisations internationales (FAO, OMS, OIE).
- Consultant indépendant en audits et certifications alimentaires.
En résumé : le vétérinaire dans l’agroalimentaire joue un rôle de garant de la santé publique, en assurant la qualité et la sécurité des aliments consommés au quotidien. C’est une voie stratégique et exigeante, au croisement de la médecine vétérinaire, de l’industrie et de la réglementation.
Fais notre Test d’Orientation Parcoursup pour savoir si tu es fait pour une école vétérinaire !
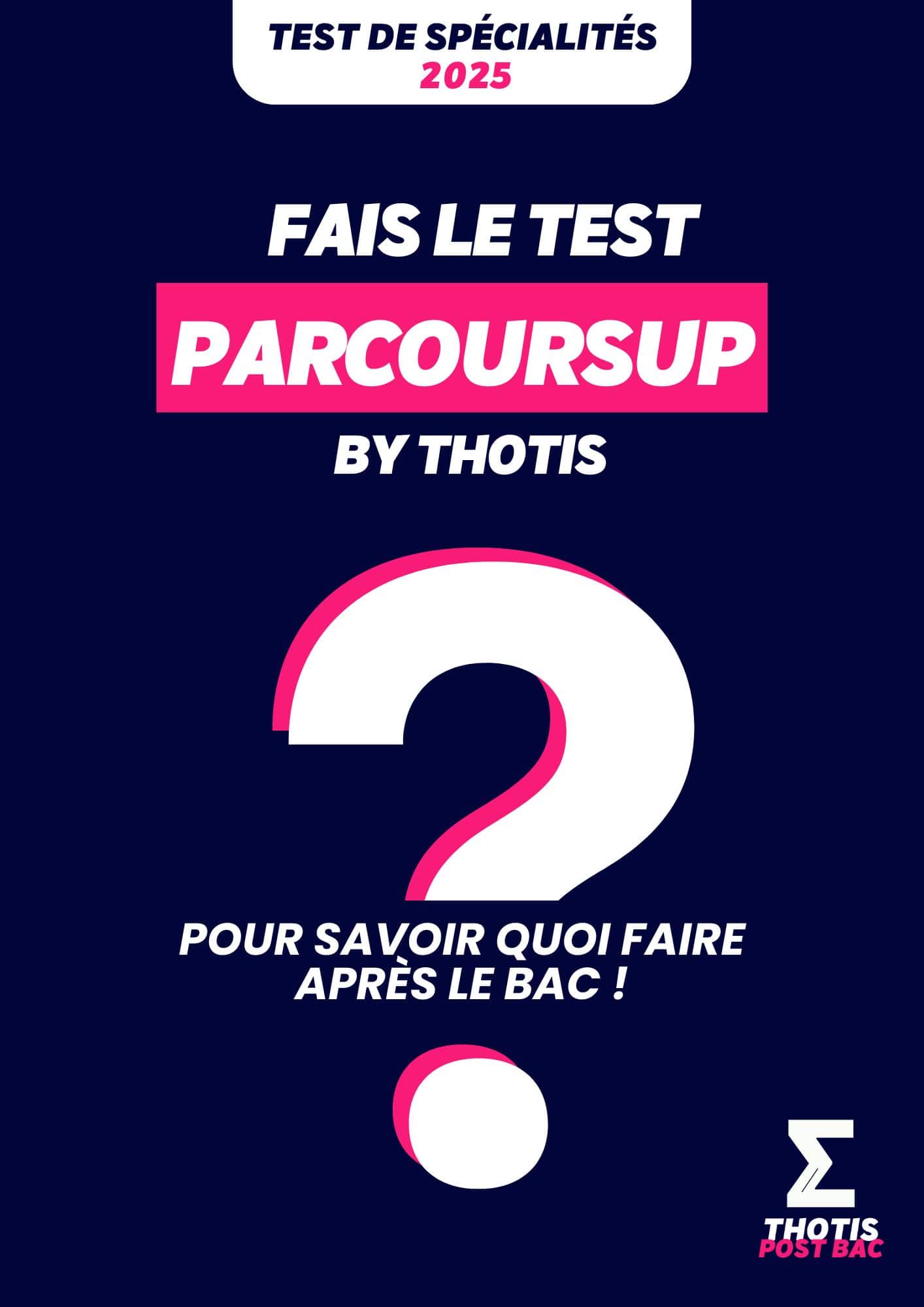
Comme tu as pu le voir précédemment, les études vétérinaire t’offrent de très nombreuses opportunités dans des domaines très variés ! Fais notre Test des Métiers pour identifier un débouché qui te plaira.
TROUVE TA VOIE
Thotis, LE média de référence pour aider les jeunes dans leurs choix d’orientation, du lycée à l’insertion professionnelle.
Chiffres clés
📍 Thotis : leader de l’orientation digitale en France
Thotis est un média digital et gratuit, imaginé par des jeunes pour accompagner les lycéens et les étudiants dans leurs choix d’orientation.
Depuis 2018, nous travaillons à rendre les formations plus lisibles et compréhensibles, en aidant chaque jeune à trouver sa voie. Pour cela, nous proposons des contenus modernes et variés : témoignages d’étudiants, immersions vidéo dans les universités et écoles, des infographies impactantes sur les réseaux sociaux et des intelligences artificielles d’orientation.
Pas besoin d’être expert pour s’y retrouver : nous expliquons les parcours, donnons la parole à ceux qui les vivent, et facilitons l’accès à une information claire et authentique.
Thotis est conventionné et travaille en partenariat avec les équipes nationales de Parcoursup, de Mon Master, les universités publiques (réunies au sein de France Universités), ainsi qu’avec les associations de professeurs de CPGE (APHEC, APPLS, UPS, UPA et UPSTI) et les associations de proviseurs (APLCPGE).






