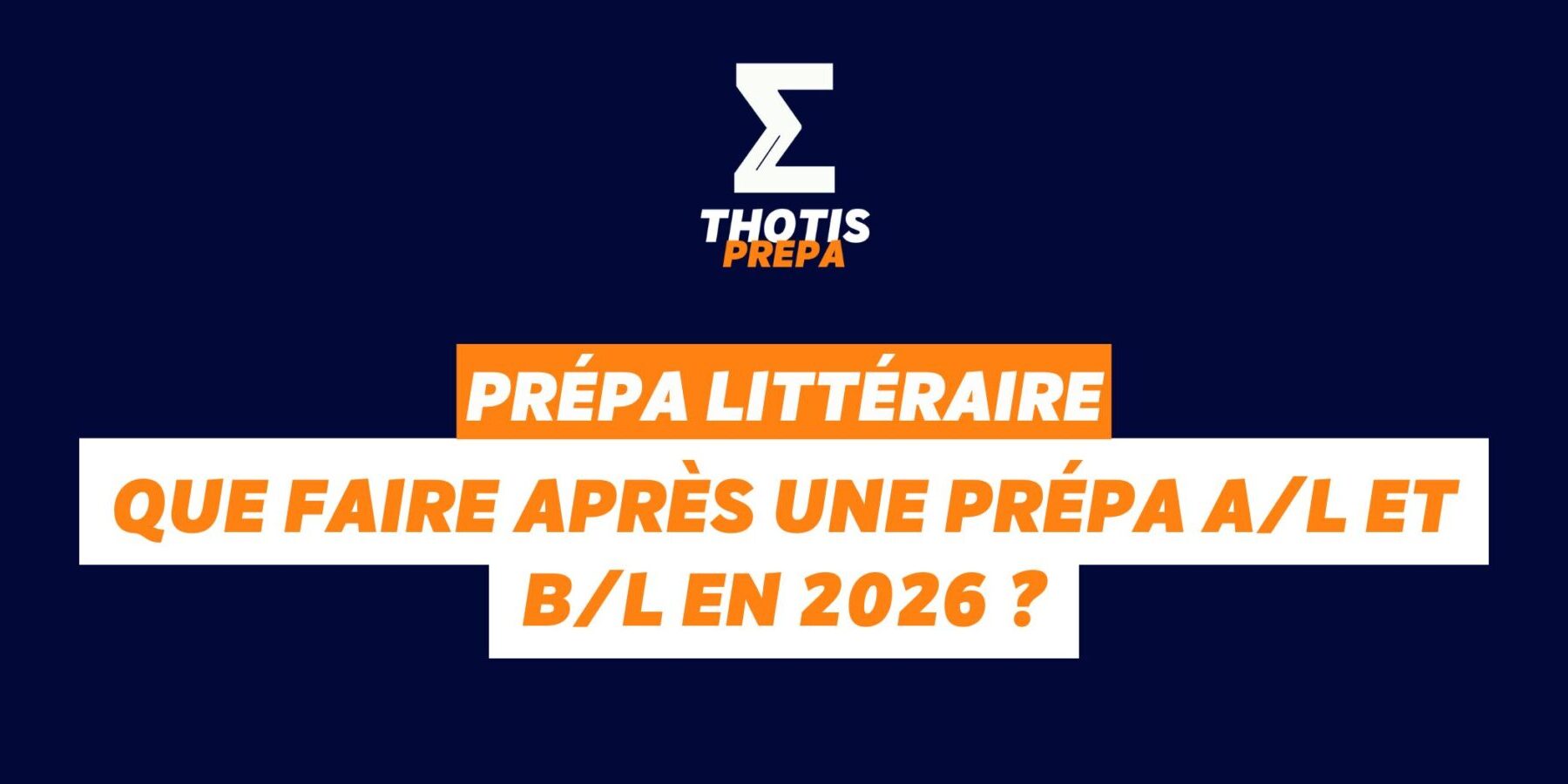Que faire après une prépa littéraire (A/L et B/L) en 2026 ?
La prépa littéraire, c’est bouché… eh bien NON ! Les classes préparatoires littéraires cassent les idées reçues. Loin de l’image dépassée d’un parcours réservé à l’enseignement ou aux métiers de la culture, elles s’imposent aujourd’hui comme l’une des formations les plus polyvalentes, exigeantes et ouvertes du paysage de l’enseignement supérieur français. Grâce à leur pluridisciplinarité -lettres, langues, philosophie, sciences sociales, histoire, géopolitique, mathématiques (en B/L)- les khâgneux peuvent désormais accéder à plus de 50 grandes écoles : écoles de commerce, ENS, écoles de data, écoles de statistique, IEP, formations culturelles, écoles d’ingénieurs, etc.
Cette diversité exceptionnelle de débouchés fait de la prépa littéraire un véritable accélérateur d’opportunités, où se développent rigueur intellectuelle, culture générale, capacité d’analyse et excellence méthodologique. Pour éclairer les enjeux, les attendus et les évolutions de ces filières, nous nous appuyons sur l’expertise de Frédéric Nau, président de l’APPLS et professeur au Lycée Louis-le-Grand.
Pour optimiser ta préparation et structurer ton projet, Thotis met à ta disposition des outils 100 % gratuits : génère ta lettre de motivation avec Thotis LM, télécharge notre Guide Prépa Thotis et retrouve ressources, méthodes et conseils sur Thotis Prépa pour t’accompagner dans ta réussite.
Quelles sont les différences entre les prépas littéraires A/L et B/L ?
La prépa A/L est centrée sur les humanités (littérature, langues anciennes, philosophie), avec une pluridisciplinarité orientée vers les sciences humaines.
La prépa B/L intègre une forte dimension mathématiques, économie et sciences sociales, indispensable pour de nombreux concours scientifiques et écoles d’ingénieurs.
Ces différences impactent autant l’admission que les débouchés (ENS, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, actuariat, statistiques…).
Quel est le profil recherché pour réussir en prépa littéraire ?
Le profil idéal repose sur deux qualités essentielles : curiosité intellectuelle et travail régulier.
Contrairement aux idées reçues, l’excellence absolue n’est pas obligatoire : on attend surtout un étudiant capable d’être motivé, constant, autonome et désireux d’apprendre dans plusieurs disciplines.
Quels concours peut-on passer après une prépa littéraire ?
Les débouchés sont très variés :
- ENS (Ulm, Lyon, Paris-Saclay)
- BEL (CELSA, Chartes, ISIT, ISMaPP, IEP, écoles ECRICOME…)
- Concours BCE pour intégrer HEC, ESSEC, ESCP, emlyon, EDHEC, SKEMA…
- Écoles d’ingénieurs via la banque BLSES (ENSIMAG, ENSEEIHT, Télécom Nancy, ENSG…)
- Écoles de statistiques (ENSAE, ENSAI)
- Écoles d’actuariat
Qu’est-ce que la Banque d’Épreuves Littéraires (BEL) ?
La BEL regroupe les épreuves écrites communes pilotées par les ENS.
Avec une seule série d’épreuves, les étudiants peuvent candidater à plus de 20 grandes écoles : CELSA, Chartes, ISIT, IEP, écoles ECRICOME…
C’est l’un des principaux débouchés pour les étudiants A/L et B/L.
Peut-on intégrer une école de commerce après une prépa littéraire ?
Oui, et les débouchés sont en forte progression : 10 % des effectifs des écoles de commerce proviennent aujourd’hui de CPGE littéraires.
Les étudiants peuvent passer :
- ECRICOME Littéraires : 195 places dédiées en 2026
- BCE Littéraires : 310 places
Ils rejoignent ensuite le Programme Grande École (PGE), formation Bac+5 reconnue par l’État.
Les étudiants de prépa littéraire peuvent-ils intégrer des écoles d’ingénieurs ?
Oui : la filière B/L offre un accès croissant aux grandes écoles d’ingénieurs grâce à la banque BLSES.
En 2026, 32 places sont ouvertes au sein du groupe GEIDIC (ENSIMAG, ENSEEIHT, Télécom Nancy, Polytech Tours) et 5 places à l’ENSG–Géomatique.
Les débouchés incluent data science, ingénierie, statistique, économie appliquée et informatique.
Quels débouchés existent dans les domaines des statistiques, de l’économie ou de la data ?
La filière B/L est particulièrement adaptée à ces secteurs.
Elle permet d’accéder à des écoles de très haut niveau :
- ENSAE (20 places B/L) – école d’application de Polytechnique
- ENSAI – filière attaché statisticien (6 places) ou ingénieur (6 places)
- Écoles d’actuariat (Dauphine, ISFA, EURIA, Strasbourg, ISUP)
Ces formations ouvrent vers la finance, data science, actuariat, statistiques publiques ou privées.
Peut-on entrer à Sciences Po ou aux IEP après une prépa littéraire ?
Non, dès l’année 2026, il ne sera plus possible d’intégrer un Sciences Po après la khâgne via la BEL.
Les étudiants peuvent en revanche toujours intégrer un Sciences Po en Master après une année universitaire.
Quelle équivalence universitaire obtient-on après une prépa littéraire ?
Chaque année validée en prépa donne droit à 60 ECTS :
- Hypokhâgne = équivalent L1
- Khâgne = équivalent L2
- Cube = équivalent L3 (180 ECTS, avec des modalités variables selon les universités)
Les étudiants peuvent donc intégrer directement une L3 ou un master via la plateforme MonMaster.
Quels conseils pour réussir sa prépa littéraire ?
Les conseils clés :
- Lire régulièrement (littérature, essais, langues étrangères)
- Travail régulier : 2 à 3 h par soir en semaine
- Maintenir un équilibre (sport, loisirs, sommeil)
- Profiter des colles : un entraînement indispensable aux oraux
- Être autonome et développer une vraie méthode de travail
La prépa est exigeante mais permet une montée en compétence remarquable et un encadrement fort.
Avant d’explorer les débouchés, rappelons les fondamentaux. Les classes préparatoires littéraires se déclinent en deux filières principales, aux profils très distincts.
« La prépa BL, c’est une prépa qui comporte un enseignement en mathématiques, en économie et en sciences sociales. Donc c’est un marqueur très très fort de ces classes », explique Frédéric Nau, professeur de littérature française et de latin en khâgne au lycée Louis-le-Grand et président de l’Association des professeurs de prépa littéraire (APPLS). « C’est aussi un critère pour y entrer puisqu’il faut avoir un vrai goût et une vraie compétence dans ces disciplines, notamment en mathématiques, il faut l’avoir pratiqué au lycée à un niveau bon, un très bon niveau même. »
À l’inverse, « pour la prépa AL, elle est plus centrée sur les humanités traditionnelles, avec notamment en hypokhâgne, un enseignement en langues anciennes qui est obligatoire. Il peut être débutant, mais il est obligatoire. Et par la suite donc, un maintien d’une pluridisciplinarité, mais centrée sur les sciences humaines et la littérature. »
Cette distinction fondamentale se reflète dès la candidature : « Pour les prépas BL, il faut vraiment avoir une formation avec une option mathématiques au lycée. Et donc, pour les prépas AL, en revanche, il n’y a pas de critères majeurs liés aux enseignements de spécialité du lycée. »
Avec le Test d’Orientation post Prépa Littéraire (AL & BL), trouve la formation qui te correspond après ta prépa littéraire
Quel profil pour réussir ?
« Le profil parfait de l’étudiant littéraire, c’est d’abord un étudiant curieux et travailleur »,résume Frédéric Nau. « Curieux parce qu’il faut avoir envie de découvrir, d’apprendre et d’assimiler des connaissances dans des disciplines diverses. Et puis, il faut être travailleur pour réussir à avoir une certaine constance, justement, dans l’assimilation, dans la pratique des exercices. »
Et contrairement aux idées reçues, l’excellence scolaire absolue n’est pas un prérequis : « Ça veut dire qu’il faut avoir un niveau honorable, mais comme il y a des prépas très variées, il n’y a pas un niveau minimal très exigeant. C’est vraiment surtout l’investissement de l’élève quicomptera. Et puis sa capacité aussi à être curieux pour différentes disciplines, l’histoire, la philosophie, les langues vivantes, par exemple. »
Le piège de l’autocensure
Sur les candidatures, le président de l’APPLS est catégorique : « Mon conseil, c’est d’abord de ne rien s’interdire, puisque nous constatons chaque année que des élèves qui n’osaient pas, n’étaient pas sûrs, ne se croyaient pas au niveau, se retrouvent en fait parmi les meilleurs.
Donc, un des gros obstacles à lever, c’est ce qu’on appelle l’autocensure, c’est-à-dire le fait que des étudiants s’interdisent eux-mêmes de postuler parce qu’ils ne se croient pas au niveau. Souvent, c’est une fausse impression. »
Sur la question des notes, il nuance : « Les notes jouent un rôle réel dans l’évaluation des dossiers parce que des notes trop faibles indiquent sans doute des difficultés qui sont peu compatibles avec le niveau d’entrée en classe préparatoire. Mais en revanche, il n’y a pas de seuil absolu parce qu’il y a diverses prépas avec différentes pratiques. »
Et d’ajouter : « Ce qui est aussi important que les notes, c’est la dynamique ; nous cherchons à observer si un étudiant progresse ou régresse, si un étudiant est investi ou pas investi, engagé dans son travail, s’il a une attitude constructive. Donc, ce sont des critères qui sont vraiment aussi importants que les notes en elles-mêmes. »
Génère ta lettre de motivation avec Thotis LM !
Pour en savoir plus sur ces prépas, découvre notre page dédiée aux prépas A/L et B/L
Utilise Thotis IA Prépa pour estimer tes chances d’entrer dans l’école de commerce de ton choix
Des concours multiples
« Les classes préparatoires littéraires ont pour mission d’aider les étudiants à entrer dans les études supérieures », rappelle Frédéric Nau. « Ça leur permet de passer de nombreux concours et les débouchés sont vraiment très variés, directement et aussi indirectement. »
Les chiffres témoignent de cette diversité : en 2023, plus de 65 000 vœux ont été formulés sur Parcoursup pour environ 12 500 places disponibles en prépas littéraires. Et contrairement aux idées reçues, 10% des effectifs des grandes écoles de commerce proviennent désormais de CPGE littéraires, un taux en progression constante.
Au-delà de l’enseignement
« Il y a encore beaucoup d’anciens étudiants de classes préparatoires littéraires qui deviennent professeurs, mais beaucoup qui font aussi tout à fait autre chose, qui passent par les IEP, par les écoles de management ou aussi par des masters qui sont très très variés », précise le professeur de Louis-le-Grand.
Les formations directement visées incluent « l’entrée dans des écoles, les écoles de management, les instituts d’études politiques, l’école des chartes, les ENS, pour citer les plus courants. »
Télécharge notre Guide Prépa Thotis
La BEL, pilotée par les trois Écoles Normales Supérieures (ENS Ulm, ENS Lyon et ENS Paris-Saclay), constitue le concours central pour les étudiants de prépa littéraire. Son principe : une seule série d’épreuves écrites communes ouvre les portes d’une vingtaine d’écoles prestigieuses.
Les écoles accessibles via la BEL
Pour les A/L : CELSA, École nationale des Chartes, ESIT, École du Louvre, ISIT, ISMaPP, et les écoles ECRICOME avec 195 places réservées aux littéraires en 2026.
Pour la filière B/L (via la banque BLSES), l’éventail s’élargit : ENSAE (20 places), ENSAI (12 places), écoles d’ingénieurs du label GEIDIC (32 places), ENSG-Géomatique (5 places), cinq écoles d’actuariat, et l’université Paris-Dauphine.
Les Écoles Normales Supérieures restent le débouché historique et le plus prestigieux. Trois établissements se partagent les candidats : ENS Ulm pour le parcours classique, ENS Lyon pour le parcours moderne, et ENS Paris-Saclay.
Environ 50 places sont offertes pour les B/L et un nombre similaire pour les A/L. Les admis obtiennent le statut de fonctionnaire stagiaire, sont rémunérés environ 1 500€ brut mensuels pendant quatre ans, mais doivent en contrepartie servir l’État pendant 10 ans (scolarité comprise).
Les ENS mènent à des carrières de haut niveau dans l’enseignement-recherche, la haute fonction publique, le conseil ou la finance, avec de nombreux doubles diplômes possibles (ESSEC, Sciences Po, ENSAE).
Découvre notre article dédiée à l’ENS !
En lien avec cet article : découvre le clasement des prépas A/L !
Rédige une lettre de motivation pour la prépa grâce à Thotis LM
Les khâgneux sont de plus en plus nombreux à être séduits par la pluralité des spécialités et débouchés des écoles de commerce. 10% des effectifs de ces écoles proviennent désormais de CPGE littéraires, une part en constante augmentation.
Le Concours ECRICOME Prépas Littéraires
Pour 2026, ECRICOME offre 195 places réservées aux littéraires (A/L et B/L) avec un dispositif avantageux : aucune épreuve écrite supplémentaire (récupération des notes BEL) et tarif de 165€ (30€ pour les boursiers).
Répartition des places 2026 :
- EM Strasbourg : 15 places
- KEDGE BS (Bordeaux & Marseille) : 50 places
- Montpellier BS : 10 places
- NEOMA BS (Rouen & Reims) : 100 places
- Rennes School of Business : 20 places
Le Concours BCE
Le concours BCE ouvre les portes des 18 écoles les plus cotées : HEC, ESSEC, ESCP, emlyon, EDHEC, SKEMA… Dix d’entre elles ont créé un concours distinct avec 310 places réservées aux littéraires.
Les khâgneux intègrent généralement la première année du Programme Grande École, cursus en 3 ans délivrant un diplôme Bac+5 visé par l’État et conférant le grade de Master.
En lien avec cet article : découvre le Concours ECRICOME
L’ENSAE : data science et économie
L’École nationale de la statistique et de l’administration économique, école d’application de Polytechnique, recrute 20 étudiants de B/L chaque année via la banque BLSES.
La formation délivre un diplôme d’ingénieur et ouvre vers la finance, la data science, l’économie et l’actuariat, avec de nombreux doubles diplômes (ENS, HEC, ESSEC, Sciences Po).
L’ENSAI : statistique publique et privée
Près de Rennes, l’ENSAI propose deux cursus distincts aux B/L :
- Cursus d’attaché statisticien de l’INSEE (2 ans, fonctionnaire rémunéré, carrière publique) avec 6 places
- Cursus d’ingénieur ENSAI (3 ans, orientation privée) avec 6 places
La triple compétence statistique-informatique-économie fait de ces diplômés des profils très recherchés dans les secteurs de la banque, de l’assurance et du conseil.
Les écoles d’actuariat
Cinq écoles d’actuariat recrutent via la banque CEAS : Paris-Dauphine, Strasbourg (DUAS), Lyon (ISFA), Brest (EURIA), Paris (ISUP). Les épreuves de mathématiques sont d’un niveau très élevé, mais les débouchés sont à la hauteur.
Quatre grandes écoles d’ingénieurs (Tours, ENSIMAG Grenoble, ENSEEIHT Toulouse, Télécom Nancy) ont créé le label GEIDIC avec 32 places réservées aux B/L via la banque BLSES.
L’École nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique) propose 5 places aux B/L pour son cursus d’ingénieur unique en France.
Le CELSA : communication et médias
L’école de Sorbonne Université forme l’élite du journalisme, de la communication, du marketing et de la publicité. Accessible via la BEL ou par concours spécifique.
ESIT et ISIT : traduction et interprétation
L’ESIT forme en master les futurs interprètes de conférence et traducteurs de haut niveau,avec exigence de maîtrise parfaite de deux ou trois langues dont le français.
L’ISIT propose des formations en management interculturel, traduction, relations internationales, accessible en L2, L3 ou M1.
ISMaPP : management public
L’Institut Supérieur du Management Public et Politique forme aux métiers des administrations publiques, de la fonction publique et de la communication politique. Accessible via la BEL ou concours spécifique.
Après trois ans de prépa (en « cube »), l’admission en M1 à Sciences Po Paris s’effectue sur dossier, éventuellement suivi d’un oral, dans l’une des 6 écoles : affaires publiques, affaires internationales, droit, journalisme, management et innovation, école urbaine. Sciences Po Lyon, Aix et Lille ne recrutent plus via la BEL depuis 2025.
« Ce qui est vraiment important, c’est que les lycéens qui réfléchissent à leur formation sachent aussi qu’après une classe préparatoire littéraire, un certain nombre de jeunes gens rejoignent l’université et peuvent postuler à des masters exigeants, intéressants », insiste Frédéric Nau. « Et donc la qualité de la formation, elle se ressent là aussi parce qu’aujourd’hui, la plateforme MonMaster permet de sélectionner, de hiérarchiser les candidatures et un passage par une classe préparatoire littéraire, c’est un vrai atout. »
Le système d’équivalences
« Après une classe préparatoire, on se retrouve forcément avec une poursuite d’études », rassure le président de l’APPLS. « Soit en licence trois, si l’étudiant fait une seule année de khâgne, c’est-à-dire la deuxième année. Souvent, les étudiants font une deuxième année de deuxième année, donc ça fait trois années. Ils atteignent ainsi le niveau de la licence trois et passent pour la plupart directement en master. »
Chaque année validée rapporte 60 ECTS : L1 après l’hypokhâgne, L2 après la khâgne, L3 après le cube. Un parcours de trois ans équivaut à 180 ECTS, soit une licence complète.
« Il n’y a pas d’étudiants qui restent sur le carreau sans trop savoir quoi faire ensuite », affirme- t-il. « C’est le début d’études longues, généralement réussies. »
Fais notre Test d’Orientation en Master pour savoir quelles sont les formations faites pour toi dans TA région !
Un rythme soutenu
« Dans les deux types de prépa, en AL et en BL, la semaine type est à peu près la même. C’est- à-dire qu’il y a d’abord une trentaine d’heures d’enseignement », détaille Frédéric Nau. « Il y a également des interrogations orales, une ou deux par semaine. Donc ces interrogations orales, ça prend une à deux heures à chaque fois. Et puis, il y a souvent des devoirs surveillés, soit répartis dans la semaine, soit parfois le samedi. »
La charge de travail personnel ? « Selon les étudiants, selon leur manière de s’organiser, deux à trois heures le soir. »
L’importance de l’équilibre
Mais attention, prévient le professeur : « Il faut aussi bien savoir qu’une bonne formation, c’est une formation équilibrée. Donc, il ne faut pas faire de nuit blanche, il ne faut pas travailler au- delà d’une certaine heure. Il faut maintenir un rythme sain aussi pour soi-même, pour son corps. »
« Il faut aussi savoir se ménager des espaces de liberté. Donc ça peut être le sport, ça peut être le cinéma, chacun a ses loisirs, mais c’est important que dans cette semaine, les étudiants sachent se maintenir des moments de respiration qui vont leur permettre d’être mieux dans leur peau et aussi donc mieux dans leurs études. Et il ne faut pas qu’ils croient que c’est tout sacrifier pendant deux ans. Ça veut dire adopter une certaine rigueur, c’est vrai, mais pas tout sacrifier. »
La charge de travail concrète
Sur la gestion quotidienne, il précise : « Cette charge de travail est importante, mais elle devient possible à gérer pour les étudiants ou les étudiantes s’ils la répartissent avec régularité sur l’ensemble de la semaine. Donc les jours où il y a cours, je pense qu’il est bien qu’un étudiant ou une étudiante travaille trois ou quatre heures par jour. »
« En fin de semaine, avec des journées plus longues, ils peuvent travailler un peu plus, mais malgré tout, en se ménageant un peu de temps libre. Donc s’ils n’ont pas cours ni de devoirs le samedi ou dimanche, ils peuvent travailler effectivement six, sept heures, mais il faut quand même aussi avoir du temps pour soi, pour voir sa famille, pour pratiquer un sport ou pratiquer un loisir. »
Les khôlles : un atout majeur
« Une colle, c’est le nom que les étudiants et les étudiantes donnent pour une interrogation orale, avec donc un temps de préparation autonome et un passage devant son professeur ou un interrogateur », explique Frédéric Nau.
« Le but premier de la colle, c’est de former aux oraux, puisque les concours que ces étudiants et ces étudiantes passent comportent un volet d’écrit, puis d’oraux. Et donc, ces colles, ce sont des simulations des oraux. »Mais leur utilité va bien au-delà : « C’est aussi en fait l’occasion d’un travail vraiment personnalisé qui permet de mesurer là où l’élève en est par rapport aux savoirs qu’il doit acquérir, qui lui permet progressivement de corriger ses erreurs, parce que ses colles sont plus nombreuses que les exercices écrits et donc, elles permettent un vrai suivi. Certains disent que c’est quasiment un cours particulier, régulier dans différentes disciplines. »
Avec le Test d’Orientation post Prépa Littéraire (AL & BL), trouve la formation qui te correspond après ta prépa littéraire
La pluridisciplinarité
« La classe préparatoire littéraire, c’est aussi une pluridisciplinarité. Donc ça permet d’avoir une formation dans différentes disciplines simultanément à un niveau exigeant », souligne le président de l’APPLS.
« C’est très important lorsque, par la suite, un étudiant se destine à faire de l’histoire, qu’il ait aussi eu une formation en philosophie, parce que ça peut, par exemple, éclairer son approche de tel ou tel phénomène. Et donc cette pluridisciplinarité, c’est vraiment une marque forte de la classe préparatoire littéraire par rapport à d’autres formations d’un type proche. »
L’encadrement et la méthode
« Les grands atouts des classes préparatoires, c’est l’accompagnement, l’encadrement, la pratique des exercices, la correction, la relation suivie tout au long de l’année avec ses camarades et avec les enseignants, et donc une transition vraiment très précise vers l’enseignement supérieur », résume Frédéric Nau.
« Il y a aussi la pratique quand même très régulière d’exercices qui fait qu’au bout de deux ou trois ans, les étudiants se sentent assez à l’aise dans des dissertations ou des commentaires qu’ils seront amenés à pratiquer par la suite. »
Un socle pour l’avenir
« Je dirais qu’une classe préparatoire, c’est d’abord une formation qui permet aux étudiants de travailler dans une classe avec un nombre raisonnable d’étudiants, très encadrés, avec une attention particulière aux exercices et à la méthode », insiste le professeur.
« Ça prépare d’abord à des concours, soit les ENS, soit les concours des écoles de management pour les classes préparatoires littéraires. Mais c’est une formation en fait qui a de nombreux débouchés et qui surtout permet d’avoir un socle très solide pour le restant de ses études. Pour moi, ça forme en fait un peu à tout, parce que justement, il y a cet accent mis sur la méthode, la maîtrise des exercices et l’assimilation de l’information. »
Se préparer dès le lycée
« Je dirais pour premier conseil, pour préparer l’entrée en prépa littéraire, de lire. Lire des ouvrages de littérature, lire des ouvrages de littérature en langues étrangères, découvrir des essais historiques, cultiver cette curiosité qui va aussi donner une forme de background quipermettra à l’étudiant d’être plus à l’aise lorsqu’il aura à traiter d’autres informations, d’autres périodes », conseille Frédéric Nau.
« Donc vraiment, qu’il y ait une forme d’ouverture culturelle maximale à une période où les lycéens ont encore un peu de temps pour eux et peuvent le pratiquer. »
La candidature sur Parcoursup
Sur la lettre de motivation, le président de l’APPLS est pragmatique : « Les lettres de motivation, évidemment, sont lues, comme l’intégralité des dossiers. Il faut surtout que les lycéens et les lycéennes pensent à nous informer de tout ce qu’ils croient utile pour éclairer leur candidature. »
« Par exemple, si un étudiant ou une étudiante a changé d’enseignement de spécialité, ça peut être l’occasion d’expliquer pourquoi, comment, ce qui l’a amené à faire ce choix. La lettre de motivation, ça peut être aussi le moment d’expliquer son enthousiasme, son envie de travailler. »
Mais il tempère : « Il ne faut pas non plus s’imaginer qu’il faut en rédiger de très longs parce que nous savons bien qu’elles sont parfois aussi aidées par l’entourage. Et donc, il faut que ça reste dans un format raisonnable et que les étudiants et les étudiantes ou les futurs étudiants et étudiantes ne croient pas que tout se joue à une sorte de capacité de convaincre sur cette lettre. »
L’état d’esprit pour réussir
Sur le choix entre licence et prépa, Frédéric Nau conseille : « Pour faire son choix, je pense que c’est important d’avoir en tête la question de la pluridisciplinarité. Il ne faut pas avoir une obsession pour une seule discipline et se dire que les autres sont un boulet. Dans ce cas-là, ce sera difficile de tenir toute la semaine. »
« Je pense que c’est important que les lycéens et lycéennes pensent au fait que les classes préparatoires sont intéressantes parce qu’elles offrent une formation assez encadrante qui permet de bien suivre l’étudiant. Donc, ça peut être vraiment quelque chose dont un étudiant a besoin et ça peut vraiment constituer une bonne motivation. »
L’importance de l’autonomie
« La différence avec le lycée, c’est d’abord une certaine exigence dans l’approfondissement, peut-être, et un rapport direct avec les sources, la bibliographie. Donc c’est un apprentissage aussi de l’autonomie par rapport à la discipline », explique le professeur.
« L’étudiant a un rapport proche avec son professeur, encore une fois, puisqu’il est très suivi. Mais malgré tout, il doit aussi apprendre à découvrir par lui-même, à assimiler par lui-même et pouvoir ainsi avoir un dialogue un peu autonome avec son professeur. Ça, je pense que c’est assez nouveau par rapport au lycée. »
Génère ta lettre de motivation pour la prépa avec l’intelligence artificielle : Thotis LM
En conclusion, Frédéric Nau résume les atouts de la filière en quelques points clés : « La formation dans une classe avec un groupe d’étudiants et d’étudiantes motivés, agréables, qui permet de ne pas se sentir seul, avec des professeurs attentifs aux besoins de chaque élève, qui là aussi, contribue à transformer le lycéen en étudiant, la pluridisciplinarité et aussi le faible coût. »
Un argument de poids : à l’heure où les formations supérieures privées coûtent des milliers d’euros par an, la prépa littéraire publique reste accessible à tous, avec un encadrement d’excellence et des débouchés multiples. 100% des khâgneux trouvent une formation de haut niveau à l’issue de leur prépa, que ce soit par concours (ENS, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs…), sur dossier (Sciences Po, EHESS, universités prestigieuses…), ou via les équivalences universitaires. Plus de 50 grandes écoles et formations d’excellence leur ouvrent les bras chaque année.
Alors, que faire après une prépa littéraire en 2026 ? Tout, ou presque. Entre les 3 ENS, les 23 écoles de commerce accessibles (BCE + ECRICOME), les écoles d’ingénieurs, les écoles de statistiques, les formations spécialisées et les poursuites universitaires, les possibilités sont quasi infinies. La prépa littéraire n’enferme pas, elle libère. À vous de choisir votre voie.