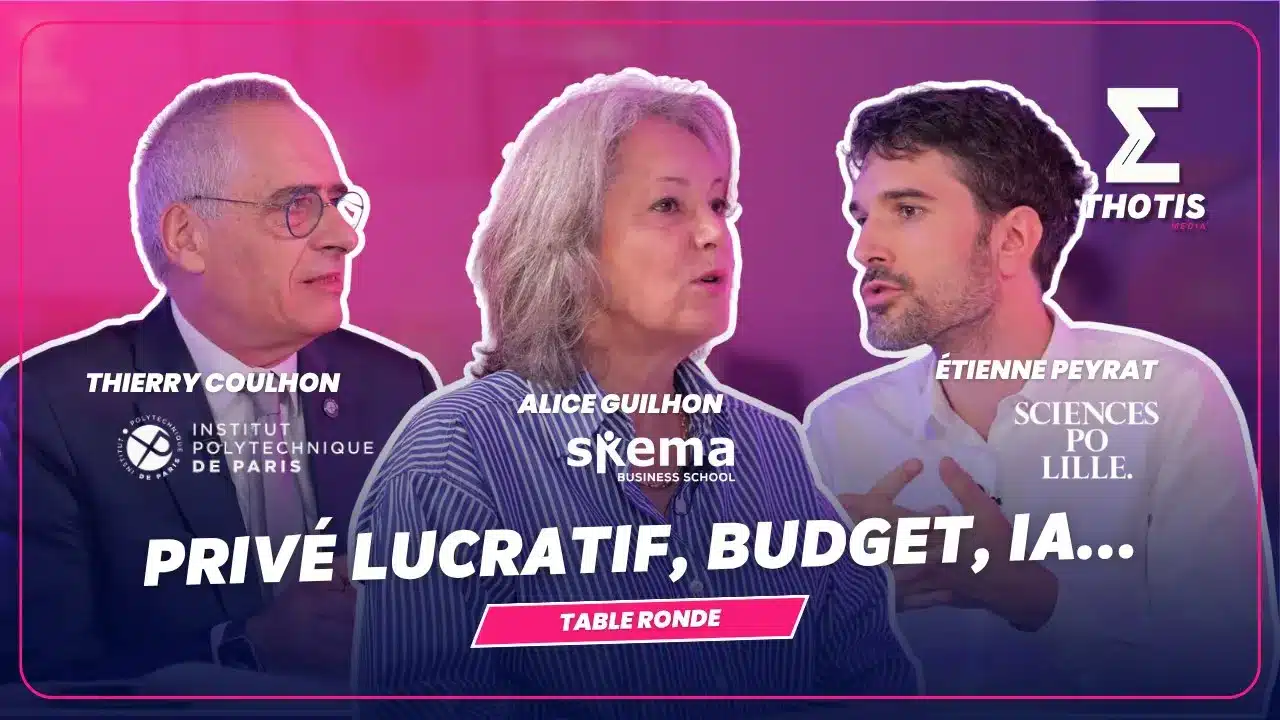Plus que jamais, les acteurs de l’enseignement supérieur évoluent dans un environnement de fortes tensions financières. Inflation, hausse des charges, diminution des dotations… Il ne s’agit plus seulement de « faire plus avec moins », mais parfois de transformer profondément son modèle économique. Le développement des ressources propres devient stratégique, tandis que la dépendance aux financements externes s’accentue. Cette instabilité, conjuguée à des priorités ministérielles changeantes, alimente un climat de défiance durable entre l’État et les établissements.
Lors de la première table ronde organisée par Thotis, trois dirigeants ont confronté leurs expériences : Thierry Coulhon, président de l’Institut Polytechnique de Paris, Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School, et Étienne Peyrat, directeur de Sciences Po Lille. Trois perspectives, trois modèles pour explorer les tensions et aspirations d’un système en quête d’équilibre entre intérêt général et contraintes économiques.
Par Valentine Dunyach et Thibaud Arnoult
Financement sous tension : érosion ou désengagement ?
Aujourd’hui, la fragilité du financement public dans l’enseignement supérieur est une préoccupation majeure. Pour Étienne Peyrat « il reste néanmoins difficile d’avoir une vision homogène sur la question tant les situations diffèrent selon les tutelles et les modèles économiques des établissements ». À Sciences Po Lille, partiellement financé par l’État, le ralentissement du soutien public oblige à développer des ressources propres. L’établissement lillois a dû compenser des subventions qui, « même si elles ne diminuent pas, restent modestes et ne couvrent ni l’inflation ni la hausse de certaines charges » insiste le directeur. Pour autant, le Directeur de Sciences Po Lille précise son propos, il ne s’agit pour lui pas de désengagement de l’Etat, mais plutôt d’érosion : « Ce n’est pas affiché, mais c’est visible. Certaines revalorisations salariales ou nouvelles charges ne sont pas compensées par l’État. ».
Une posture qui ne fait pas consensus parmi les acteurs du secteur qui s’élèvent en nombre contre ce qui est estimé comme un désengagement pur et simple. Thierry Coulhon adopte, quant à lui, un regard à contre-courant sur la question. « Si on prend un peu de hauteur pour examiner la situation économique de l’enseignement supérieur et sa relation à l’État, je crois qu’avant de parler de désengagement, on pourrait déjà saluer son engagement », nuance le Président de l’Institut Polytechnique de Paris.
Pourtant, les signaux d’alerte se multiplient. Ces deux dernières années, plusieurs formations stratégiques ont été contraintes de fermer ou de réduire leurs capacités. Malgré une pénurie avérée d’ingénieurs, Mines Saint-Étienne voit par exemple sa dotation publique reculer de 8 % en 2025. Autre illustration marquante : la fermeture de l’école de psychomotricité de Sorbonne Université, en décembre 2024 faute d’avoir reçu le moindre financement dédié « depuis plus d’une décennie », selon l’établissement, alors même que le secteur paramédical est en demande. Autant de faits face auxquels Thierry Coulhon temporise : « Arrêtons de parler de désengagement, sinon les Français vont finir par y croire ». L’ancien président de l’HCERES refuse le récit noir et appelle à la fin d’une « chanson » qu’il juge « doloriste ». « Dire que l’État se désengage, c’est un jeu dangereux. L’État est engagé, fortement, et depuis des années. ». Il cite en exemple le développement de l’apprentissage, massivement soutenu ces dernières années, ainsi que les programmes d’investissements d’avenir, qui ont profondément transformé le paysage universitaire à Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Saclay, ou encore Paris Sciences & Lettres. Le Président du directoire de l’Institut Polytechnique de Paris soutient que le débat ne porte donc pas tant sur le désengagement, mais davantage sur l’efficacité des moyens engagés : “Il faut se demander si ces investissements ont produit les effets attendus en matière de recherche et d’attractivité.”
Et profite de ce débat pour reposer clairement sur la table la question sensible des droits d’inscription des étudiants étrangers. Le dispositif « Bienvenue en France » devait permettre à l’État de partager la charge du financement avec les étudiants non-européens plus aisés : « On leur demandait de financer un tiers du coût réel de leur formation. Cette ressource, pourtant légitime, n’a pas été pleinement mobilisée. »
S’il combat l’idée d’un retrait massif de l’État, Thierry Coulhon reconnaît cependant que le système d’allocation des moyens publics est devenu illisible : « Il a été modifié par strates successives. Une remise à plat s’impose pour retrouver équité et efficacité. »
En lien avec cet article : France Universités alerte sur la situation critique du financement des établissements
Maintenir son autonomie économique dans l’instabilité réglementaire : le défi des Ecoles de management
Pour les Écoles de management, les contraintes financières liées aux décisions de l’État sont moins aiguës. « Nous ne souffrons pas de faim publique », rappelle Alice Guilhon. Pour autant, si leur modèle repose sur une autonomie économique solide, l’instabilité réglementaire fragilise néanmoins les business models. « Ce que nous demandons, et j’ai plaidé pour cela pendant des années, c’est un cadre suffisamment clair dans lequel nous puissions travailler et déployer nos stratégies, sans avoir à nous adapter à des règles mouvantes tous les deux ou trois ans », soupire-t-elle. La Directrice de SKEMA insiste : la stabilité réglementaire est devenue une condition sine qua non du développement des écoles de management en France.
Pour bon nombre d’entre elles l’international constitue un moteur essentiel de croissance. « Dans une économie française et européenne en berne, on attend de nous que nous générions de la croissance, et elle se situe à l’international », précise Alice Guilhon. Les étudiants étrangers attirés par les écoles françaises, ainsi que la mobilité des étudiants français à l’étranger, sont autant de leviers stratégiques pour consolider le rayonnement des établissements. Pourtant, Alice Guilhon regrette que des incertitudes autour des visas freinent ce potentiel. « La mobilité internationale est perçue comme un risque, alors qu’elle est vertueuse ».
Au-delà de l’international, certaines écoles diversifient leurs champs d’expertise, à l’image de SKEMA avec la création d’une École de la Professionnalisation ou encore de Géopolitique. Cette diversification n’est pas seulement une stratégie de revenus, mais bien une contribution sociétale comme s’en défend l’ex-Présidente de la CDEFM. « Cela montre que des écoles très qualitatives peuvent transformer la société, répondre à des marchés en tension, et pas seulement délivrer des diplômes Bac+5. ». Elle rappelle également que les écoles de management ont longtemps été mal comprises dans le débat public : « On a trop souvent opposé les formations professionnalisantes aux Grandes Écoles, comme si nous ne préparions pas nous aussi des professionnels. » Selon elle, l’enjeu est d’élargir l’offre pour répondre aux besoins concrets des entreprises et former des talents à tous les niveaux, pas uniquement dans les formations longues.
Les contraintes institutionnelles
Télécharge notre guide Parcoursup et reçois 300 exemples de lettres de motivation
Faut-il repenser l’évaluation et le financement des universités ?
L’évaluation des universités, comme leur financement, continue-t-elle aussi de nourrir le débat public. Thierry Coulhon, ancien président du HCERES, appelle à prendre du recul face aux critiques la qualifiant de bureaucratique et coûteuse. « Supprimer le HCERES serait-il vraiment une priorité ? Je crois que la réponse est claire : non », affirme-t-il. Selon lui, cette évaluation, même si elle est présentée comme coûteuse, offre une vision précise et rigoureuse du système. « À mon époque, le budget était d’environ 18 à 20 millions d’euros. Comparé à la Grande-Bretagne, où l’évaluation peut coûter 180 millions, c’est modeste. Ces 18 millions permettent des rapports détaillés sur la recherche et la formation, sur des budgets de plusieurs milliards. »
Il insiste sur la valeur du travail par les pairs : « Chaque année, 4 000 experts participent aux évaluations. Ce n’est pas une bureaucratie creuse, mais un véritable travail scientifique qui permet aux établissements de se situer nationalement et internationalement. » Enfin, il souligne la singularité du HCERES en Europe : « Il n’évalue pas seulement les formations, mais aussi la recherche et les établissements dans leur globalité. Supprimer cette institution serait une erreur. »
L’apprentissage : un levier vertueux à encadrer
La réduction des financements liés à l’apprentissage crée elle aussi le débat. Alice Guilhon estime qu’elle peut se justifier, à condition qu’elle s’accompagne d’une régulation stricte. « Seules les écoles reconnues par le ministère, évaluées et dotées de visas et de grades devraient pouvoir former des apprentis dans des conditions de qualité », dénonce-t-elle, pointant la prolifération des « 500 à 600 officines » non reconnues qui délivrent des titres RNCP à d’autres établissements : « Le système est devenu monstrueux. »
À l’image de Patrick Martin, Président du Medef, qui rappelait récemment que « le stage et l’apprentissage sont de formidables leviers pour découvrir les métiers et révéler les talents », la Directrice de SKEMA insiste sur la nécessité de préserver ce dispositif vertueux, tout en encadrant strictement les financements pour qu’ils bénéficient aux établissements sérieux. « Plutôt que de s’inquiéter d’une baisse des financements, il faut s’assurer qu’ils profitent aux écoles reconnues et évaluées par le HCERES, et réguler les autres acteurs délivrant des certifications RNCP. »
Elle évoque également une contribution modulée des familles des apprentis comme levier de développement : « Les familles prêtes à participer pour un tiers du coût permettraient de développer davantage les formations par apprentissage, tout en préservant la gratuité pour les étudiants boursiers. » Une approche qui, elle le répète, garantit égalité, inclusion et renforcement du lien avec les entreprises.
À découvrir également, sur Thotis : notre page dédiée aux écoles de management
Entre droits modulés, fonds privés et … appels à projet
Face à la baisse des financements publics, certaines institutions ont choisi de moduler les frais d’inscription en fonction des revenus des étudiants et de leurs familles. À l’image de Sciences Po Lille, dont les frais de scolarité vont de 0 € pour les élèves boursiers à 6 400 € pour les revenus les plus élevés. « C’est devenu un élément essentiel de notre modèle. Nous devons non seulement maîtriser nos dépenses, mais aussi défendre nos ressources », explique Étienne Peyrat. Ce dernier souligne que ces droits financent la formation, la recherche, l’accompagnement étudiant et la vie de campus, tout en nourrissant certains débats en interne : « Les discussions sur ces droits modulés sont vives, et c’est très sain »
Les fonds privés viennent compléter les ressources de l’établissement lillois, et sont notamment alloués à des projets de démocratisation ou pour faciliter l’accès des collégiens et lycéens de toute la région Hauts-de-France : transport, hébergement, etc. « Chercher un soutien privé sur ce type de projets me semble tout à fait légitime, d’autant que ces initiatives répondent aussi au souhait d’entreprises et de fondations de s’investir dans des causes éducatives au service de la société », ajoute Étienne Peyrat.
À l’Institut Polytechnique de Paris, avec plus de 430 M€ de recettes en 2025 (dont 40 M€ de financements privés), la situation demeure soutenable. Récemment, l’établissement a également bénéficié de 70 M€ dans le cadre de l’appel à projets Cluster IA. Thierry Coulhon, son président, s’en félicite. « Les appels à projets structurants ont permis au système de progresser. Avec ces 70 millions d’euros, notre responsabilité est de mériter chaque euro en produisant des effets tangibles, notamment pour développer une intelligence artificielle souveraine en Europe ». Sans nier pour autant qu’il faudra rationaliser « les dispositifs trop nombreux et de faible montant ».
Enfin, le président rappelle la complémentarité des financements : « La recherche reste massivement financée par l’État, seul capable de prendre des risques à grande échelle. Les fonds privés viennent compléter ce soutien, ce qui est naturel et sain. Cette combinaison permet d’assurer la compétitivité et l’innovation de nos établissements tout en garantissant un équilibre économique durable. »
Ces appels à projets créent-ils un enseignement supérieur à deux vitesses, entre lauréats et non-lauréats ? Thierry Coulhon s’en défend : « Les différences de financement existent depuis toujours entre certaines organisations parisiennes et d’autres. L’essentiel est que ces crédits publics soient mérités et utilisés pour produire des formations de qualité et des retombées concrètes pour la société. »
Diversité des modèles : entre performance et équité
Autant de contraintes externes qui poussent à une diversité des modèles stratégiques dans l’enseignement supérieur, qu’Alice Guilhon trouve naturelle. « Je ne pense pas que toutes les écoles doivent suivre le même modèle. Cela dépend de leur histoire, de leurs racines et des choix stratégiques qu’elles veulent mettre en œuvre. Certaines écoles peuvent être locales ou régionales, tandis que d’autres visent un rayonnement national ou international. Aucun modèle n’est intrinsèquement meilleur ou pire. »
Déjà chahutée sur le sujet des financements privés par le passé, la Directrice rappelle que recourir à ce type de fonds peut être légitime pour soutenir la croissance : « Toutes les entreprises en forte expansion utilisent un financement externe à un moment donné. Cela ne signifie pas vendre l’école. C’est un moyen d’accompagner la croissance, que ce soit au niveau régional, national ou international. »
Pour autant, tous les modèles ne peuvent pas être équitables : « Chacun doit décider de sa stratégie, de ses financements et de ses priorités, en fonction de son histoire, de ses objectifs et de son équipe dirigeante. La diversité des approches est une richesse pour notre enseignement supérieur. »
Instabilité politique : garder le cap dans la tempête
Au cœur des turbulences vécues par les acteurs du secteur : l’instabilité politique. Étienne Peyrat met cette situation sensible en perspective. « Sur le plan du pilotage et de la gestion, tous les établissements publics subissent potentiellement les mêmes impacts ». Ce que le Directeur de Sciences Po note ce sont les répercussions sur les étudiants, surtout dans les débats et conférences : « Nos étudiants sont tout particulièrement sensibles aux questions politiques, sociales et économiques. Selon le type d’établissement, école d’ingénieur, école de commerce ou institut d’études politiques, l’environnement général n’a pas le même impact. »
Il parage dans le même temps une perception préoccupante sur le sujet. « Ce qui me frappe aujourd’hui, c’est que, malgré l’intérêt pour ces questions, la situation semble susciter un mélange de consternation et de désarroi. À la rentrée, on aurait pu s’attendre à des mobilisations, comme par le passé, mais elles restent limitées. » Le Directeur de Science Po Lille s’interroge sur les conséquences à moyen terme : « Même si à court terme on peut se dire “ouf, c’est calme”, il est inquiétant de constater que certains jeunes semblent se demander si cela vaut la peine de s’engager, que ce soit dans le public ou le privé. Cette perception peut affecter l’engagement individuel et collectif dans les années à venir. »
Sur cette question, Thierry Coulhon se veut, quant à lui, rassurant. « On a parfois le sentiment que la France est un pays qui découvre que la démocratie consiste à débattre et à faire des compromis. Cela peut sembler anxiogène, mais ce n’est pas inédit. » Le Président d’IP Paris insiste : cette instabilité apparente ne doit pas être surestimée : « Il existe une continuité dans nos institutions et dans nos initiatives d’excellence. Des programmes lancés sous Hollande ou Macron ont perduré. Les ambitions de créer des “grands championnats internationaux” restent, même si nous ne sommes pas encore au niveau du MIT, du Caltech ou du Technion. »
Selon lui, ce qui compte, c’est la stabilité relative et la clarté dans l’action. Un point de vue défendu également par Alice Guilhon, pour qui la priorité de l’enseignement supérieur aujourd’hui est de pouvoir travailler sereinement. « Les enseignants et les chercheurs ont besoin de stabilité. Nous avons besoin d’un pont international, d’une richesse d’étudiants divers et de critères clairs pour continuer à former les futurs leaders et faire partie des grands champions », explique-t-elle. Malgré les contraintes budgétaires, la Directrice de SKEMA reste néanmoins optimiste. « Nous avons les moyens de continuer. Même si certaines ressources financières font défaut, elles peuvent être trouvées par ailleurs. Nos classements internationaux le montrent : les 30 écoles de management françaises sont bien positionnées dans le Financial Times, pour le master de finance, le master en management ou le Global Executive MBA. La performance est là, il faut continuer à la soutenir avec efficacité et tranquillité. »
Enfin, elle appelle à une priorité claire pour l’État : soutenir la recherche, y compris sur des enjeux stratégiques comme l’intelligence artificielle, tout en utilisant les contributions des étudiants internationaux pour compléter les financements. « Les grandes universités et les instituts comme SKEMA sont des acteurs plus modestes, mais il est crucial que le gouvernement définisse des priorités et mette les ressources là où elles peuvent créer un impact réel », conclut-elle.
Des questions sur ta poursuite d’études ? Viens discuter avec Thotis.IA, le conseiller d’orientation 2.0 généré par une intelligence artificielle