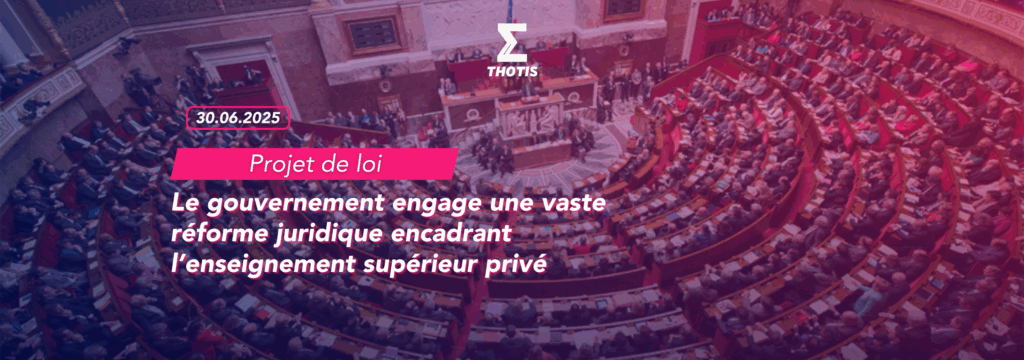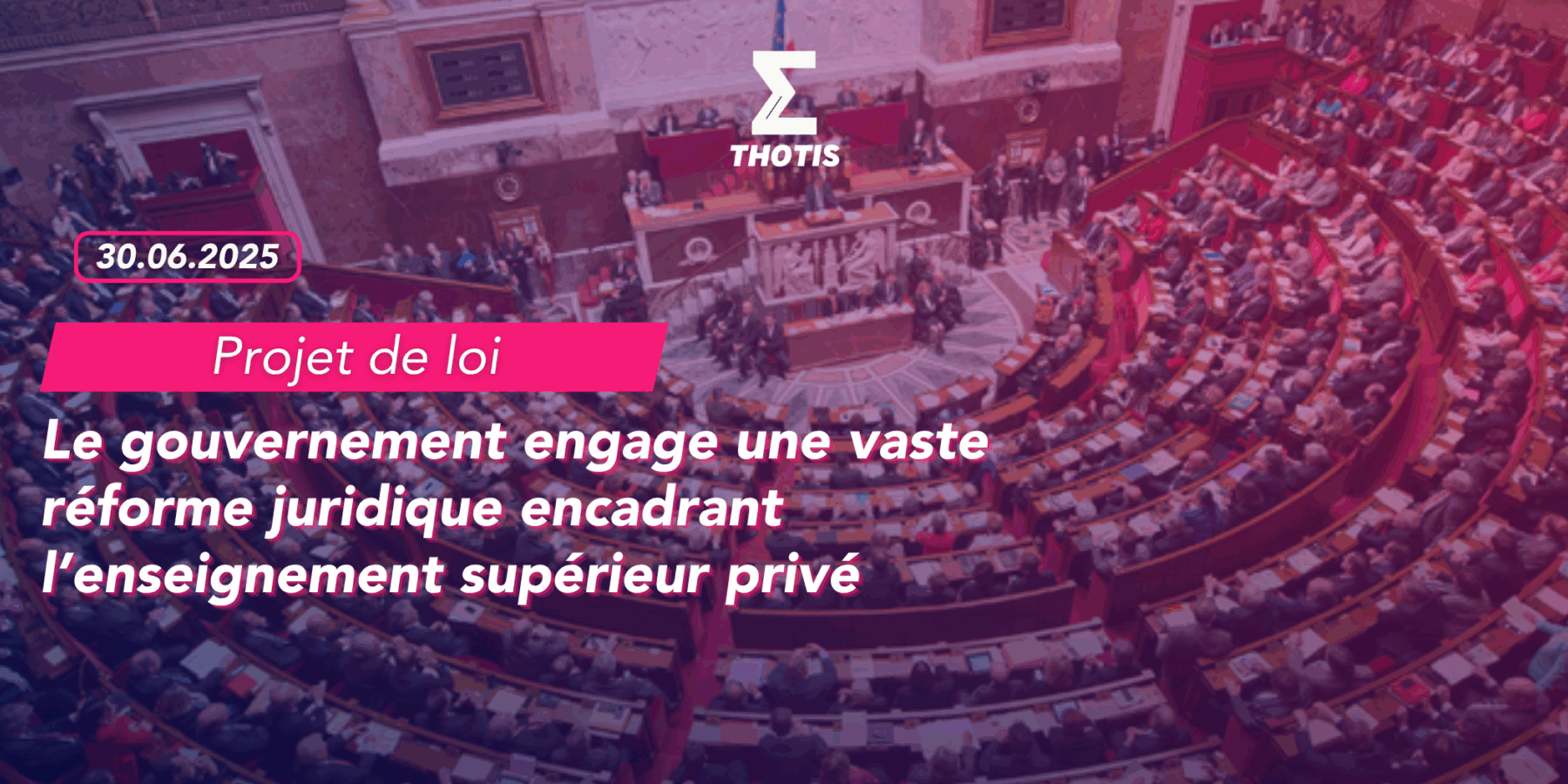Le gouvernement engage une vaste réforme juridique encadrant l’enseignement supérieur privé. Agrément, partenariat, diplômes, protection des étudiants, certification Qualiopi, procédures d’ouverture : le projet de loi « modernisation et régulation de l’enseignement supérieur » redessine en profondeur les règles du jeu pour les établissements privés. Tour d’horizon des principales mesures qui pourraient transformer durablement le paysage de l’enseignement supérieur en France.
Comme le décrypte une dépêche de nos confrères de l’AEF, un projet de loi sur la modernisation et la régulation de l’enseignement supérieur a vu le jour. Celui-ci introduit deux nouvelles formes de reconnaissance pour les établissements privés : l’agrément et le partenariat. Ces dispositifs deviendront obligatoires pour qu’une formation puisse être référencée sur Parcoursup. L’agrément est accessible à tous les établissements privés d’enseignement supérieur, y compris les organismes de formation. Il atteste de la qualité globale de l’offre de formation, sur la base d’une évaluation conduite par une instance nationale indépendante. Cette évaluation porte notamment sur la stratégie et le pilotage de l’établissement, sur la pertinence de son offre de formation ainsi que sur l’existence d’une politique sociale en faveur des étudiants. L’agrément est délivré pour une durée limitée, sous le contrôle de l’État, et pourra être reconnu automatiquement si un autre ministère ou une collectivité a déjà délivré un agrément équivalent. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’application, incluant la durée, le renouvellement, la suspension et le retrait de cet agrément. Le partenariat, quant à lui, est réservé aux établissements à but non lucratif. Il permet à ces établissements de participer pleinement aux missions de service public de l’enseignement supérieur, notamment par l’adossement des formations à la recherche et la mise en place d’un accompagnement social des étudiants. Ce partenariat ne peut être conclu qu’à la suite d’une évaluation préalable, elle aussi menée par une instance nationale indépendante, qui porte sur la non-lucrativité de l’établissement, sa gouvernance, sa politique de formation, son lien avec la recherche et son organisation de la vie étudiante. Il donne lieu à une contractualisation avec l’État, qui en contrôle l’exécution. Tous les établissements privés non lucratifs pourront en bénéficier, et plus seulement les établissements Eespig, même si seuls ces derniers continueront à percevoir un financement public. Là encore, un décret en Conseil d’État viendra encadrer les conditions d’application, notamment celles relatives à la durée, au renouvellement, à la suspension ou au retrait du partenariat. Ces deux dispositifs visent à clarifier et renforcer la régulation des établissements privés, avec un recentrage sur la qualité, la transparence et la participation au service public. Le projet de loi vise à simplifier et harmoniser les procédures de déclaration d’ouverture des cours et établissements d’enseignement supérieur privés en unifiant leurs régimes juridiques et en clarifiant les motifs d’opposition possibles par les autorités compétentes. Ainsi, l’autorité administrative ou le procureur de la République peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou établissement privé pour des raisons d’ordre public, de non-respect des conditions légales, ou si le projet ne correspond pas à un établissement d’enseignement supérieur privé. Cette opposition est aussi maintenue pour prévenir toute ingérence étrangère ou protéger les intérêts nationaux. En l’absence d’opposition dans les délais légaux, l’ouverture est automatiquement autorisée. La déclaration préalable d’ouverture d’un cours doit désormais inclure des informations sur le déclarant, les locaux, et les contenus d’enseignement. Elle est adressée aux autorités qui délivrent un accusé de réception, puis l’ouverture peut intervenir deux mois après, sauf opposition. Pour les établissements, la déclaration doit être signée par au moins trois administrateurs et contenir des informations sur l’activité, les diplômes délivrés, le personnel, les locaux et la personne morale responsable. Les établissements doivent aussi transmettre chaque année au recteur la liste des professeurs, les programmes et diplômes, sous peine d’une amende. Des mesures transitoires prévoient que les procédures en cours restent soumises à l’ancienne réglementation, et que les établissements techniques privés disposent d’un délai d’un an pour se conformer aux nouvelles règles.
En lien avec cet article : France universités rappelle l’urgence d’une régulation de l’enseignement supérieur lucratif
France Universités rappelle l’urgence d’une régulation de l’enseignement supérieur privé lucratif
Le projet de loi met fin à la qualification Eespig pour les nouveaux établissements. Ceux déjà labellisés conserveront leur statut, mais toute nouvelle demande sera automatiquement requalifiée en « partenariat », selon le nouveau cadre juridique. Les Eespig existants bénéficieront d’un agrément automatique pendant la durée de leur contrat, qui vaudra également partenariat. Ce statut pourra toutefois être retiré en cas de manquement aux obligations légales ou contractuelles. Les établissements techniques et consulaires déjà reconnus par l’État obtiendront aussi un agrément de manière transitoire. Les formations des établissements agréés, sous partenariat ou Eespig continueront à figurer sur Parcoursup, mais pourront en être retirées en cas de non-respect des règles. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2026, pour s’appliquer dès la campagne d’admission de la rentrée 2027. Un régime transitoire est néanmoins prévu jusqu’en 2029, afin de maintenir certaines formations sur Parcoursup, notamment celles des Eespig ou des établissements sous contrat déjà référencées. Enfin, le projet supprime le CCESP, dont les missions d’évaluation devraient être reprises par le HCERES. Le projet de loi prévoit que seuls les établissements privés agréés ou sous partenariat avec l’État pourront obtenir la reconnaissance de leurs diplômes ou délivrer un grade universitaire. Cette reconnaissance sera accordée après une évaluation par une instance nationale indépendante, tenant compte de la qualité académique, des besoins socio-économiques, de la carte des formations, et, pour les grades, de l’adossement à la recherche. Pour les diplômes d’ingénieur, la décision d’autorisation ne reviendra plus à la CTI, mais à l’administration, après avis de la CTI. Les demandes déjà en cours resteront régies par l’ancien cadre. Seuls les établissements agréés ou sous partenariat pourront également signer des conventions avec des établissements publics pour permettre à leurs étudiants d’obtenir des diplômes nationaux. En l’absence d’accord, le recteur pourra fixer les modalités de contrôle des connaissances, après vérification de la conformité de la formation. Enfin, les établissements techniques et consulaires déjà reconnus par l’État conserveront temporairement leurs habilitations, et l’article sur la délivrance de certificats d’études par les écoles techniques privées est abrogé. En lien avec cet article : Suppression du HCÉRES confirmée par l’Assemblée nationale Le projet de loi prévoit l’extension de l’obligation de certification Qualiopi à tous les organismes dispensant des formations menant à un titre professionnel enregistré au RNCP, quelle que soit la source de financement. Jusqu’ici, cette obligation concernait principalement les formations financées par des fonds publics ou mutualisés, notamment en apprentissage. Cette mesure vise à élargir le champ du référentiel national qualité et à renforcer la protection des apprenants, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. Un nouvel article précise que cette certification devra désormais être obtenue selon les mêmes modalités pour l’ensemble des formations conduisant à un titre RNCP. L’entrée en vigueur de cette obligation est prévue un an après la promulgation de la loi. En revanche, les établissements privés agréés ou sous partenariat, tout comme les établissements publics accrédités, seront réputés avoir satisfait automatiquement à cette obligation de certification. Enfin, le ministère de l’Enseignement supérieur et celui du Travail devraient présenter début juillet les nouveaux critères renforcés de Qualiopi. Le projet de loi renforce la protection des étudiants et des apprentis inscrits dans l’enseignement supérieur privé, en s’inspirant du droit de la consommation pour mieux encadrer les pratiques contractuelles. Pour les étudiants, un droit de rétractation de 30 jours avant le début de la formation est instauré. Il permet à l’étudiant ou à son représentant légal de résilier le contrat d’inscription sans justification ni frais, à l’exception des frais administratifs. Toute somme déjà versée, y compris les frais de réservation, devra être remboursée dans un délai de 30 jours. Les clauses contraires seront réputées non écrites, et les établissements en infraction s’exposeront à des amendes administratives pouvant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces dispositions, désormais intégrées dans un nouveau chapitre du code de l’éducation, sont d’ordre public, ce qui signifie qu’aucun contrat ne peut y déroger. Du côté des apprentis, le projet de loi interdit certaines clauses abusives dans les contrats passés avec les centres de formation d’apprentis (CFA). Il devient interdit d’exiger des frais de réservation avant confirmation de l’inscription. En cas de départ anticipé, les établissements devront rembourser les frais de scolarité au prorata temporis. Enfin, les frais versés avant l’inscription définitive devront être restitués dans un délai de trois mois, conformément à la législation sur l’apprentissage. Ces mesures visent à mieux protéger les jeunes contre des pratiques commerciales jugées abusives. Mention : cet article est une reprise de dépêche AEF (dépêche n°733701)
Deux nouvelles formes de reconnaissance pour les établissements privés
L’agrément
Le partenariat
Harmonisation des procédures de déclaration d’ouverture des établissements privés
La fin de la qualification Eespig et la suppression du CCESP
Diplômes reconnus : la fin de l’accès automatique pour le privé
Extension de l’obligation de certification Qualiopi à tous les organismes délivrant des titres RNCP
Mesures renforcées pour protéger les étudiants et apprentis : droit de rétractation et clauses abusives